Dès mai 1842, un projet fut présenté au Ministre de la Guerre, émanant de Me. ACHARD, notaire, maire de Hochfelden et Conseiller général du Bas-Rhin.
Il dresse un portrait des émigrants potentiels en Alsace, précise les raisons qui les pousseraient à s'expatrier, et propose des solutions.
Nous sommes sous la Monarchie de Juillet, et c'est Louis-Philippe qui est le roi. Sur les 34,2 millions de français, on compte 6,9 millions de propriétaires de terres agricoles, mais 90% d'entre-eux possèdent et/ou exploitent moins de 5 hectares. C'est le cas en Alsace où la propriété agricole est très morcelée. La vie est difficile, et une grande misère règne à la campagne.
Depuis 1840, les villes commencent à recevoir régulièrement l'apport d'une population d'origine rurale, de 40 à 50.000 personnes par an, souvent des cadets de famille et des petits journaliers issus des terroirs surpeuplés.
Ce sont surtout les centre-ville qui subissent l'afflux de population d'où une dégradation des conditions d'habitat et de fonctionnement... et une dilatation des villes en direction des faubourgs et des zones d'urbanisation nouvelles. ("Contexte", Th. Sabot, 2007).
Les ouvriers des cités connaissaient eux aussi une sombre misère. Tout cela dans un contexte difficile : fréquents changements dans les ministères, la Chambre dissoute (en juin), les attentats....
Cela fait 12 ans que la France a débarqué en Algérie. Le pays n'est pas encore pacifié dans sa totalité, et la colonisation traîne à se mettre en route. Déjà, on pensait au débouché Algérien pour désengorger les villes et donner du travail aux chômeurs, des terres à cultiver aux agriculteurs.
Pour étudier plus avant cette question, le gouvernement décide la création d'une mission qui se rendra sur place. On charge de cela un vieux soldat de l'Empire, Nicolas Jean-de-Dieu SOULT, maréchal (promotion de 1804), duc de Dalmatie, et présentement Ministre de la Guerre.
Un groupe de 9 personnes est formé, conduit par Me. ACHARD, notaire à Hochfelden (Alsace, Bas-Rhin), maire de ce village et membre du Conseil général du département.
Parti de Strasbourg, les voyageurs arrivent à Toulon le 27 décembre 1841, vers 23 heures. Un bateau partait pour l'Algérie le lendemain, mais à cause d'un problème administratif à la sous-intendance militaire, pour la régularisation de leur embarquement, ils ne purent embarquer sur ce bateau, et durent séjourner une semaine à Toulon. Le 3 janvier 1842, ils montent à bord de "La Chimère" et arrivent à Alger le 7 au soir.
Durant leur séjour en Algérie, les délégués parcourent le Sahel dans tous les sens, de la mer à la plaine, de Fouka et Kaléah à la Maison-Carrée et la plaine, autant que le temps et la prudence le leur permirent.
Ils ont vu les villages commencés et les emplacements de tous ceux projetés. Ils ont recueillis les idées du Gouverneur général et du Directeur de l'Intérieur sur la colonisation. Ils ont observé de près et en détail, la population répandue sur place, la nature et l'espèce des ouvriers et colons (ou soi-disant colons) débarqués chaque semaine à Alger.
Ils ont observé ce qui existe alors de culture, ce qu'on peut espérer du sol avec une population active, vigilante et véritablement agricole.
Selon les propres paroles de Achard : "Enfin j'en ai assez vu, assez appris pour me former une idée exacte du pays, de ses ressources, de ses besoins, du parti qu'on peut en retirer, et de ce qu'il faut pour établir la colonie sur des bases solides et la mettre en voie de prospérité."
En mai 1842, ACHARD présente son projet au Ministre.
LE PROJET ACHARD ET SON RAPPORT AU MINISTRE.
Observations préliminaires.
A Monsieur le Maréchal, duc de Dalmatie, président du Conseil, Ministre Secrétaire d'Etat de la Guerre.
Monsieur le Ministre,
J'ai à vous rendre compte de la mission dont vous m'avez honoré, mais, avant d'en venir à mon rapport, permettez-moi de vous présenter quelques observations préliminaires et de vous expliquer, avant tout, comment il se fait qu'un notaire de campagne se trouve mêlé à une question aussi importante et aussi brûlante d'actualité que celle de la colonisation de l'Algérie.
Etabli depuis passé vingt ans en Alsace, j'ai étudié les mœurs et le caractère de ses habitants, si différents de ceux des autres départements.
J'ai admiré le haut degré de perfection auquel ils ont poussé l'agriculture, l'éducation des bestiaux, et y ai reconnu la cause de l'énorme différence de revenu qui existe entre la même quantité de biens loués dans ce pays et d'autres de l'intérieur, et même limitrophes.
Devenu ensuite témoin oculaire de nombreuses émigrations, toutes sans exception, dirigées vers l'Amérique, j'ai cherché à m'expliquer comment, avec tant d'éléments de prospérité, un sol admirable et fertile, des populations entières en venaient à s'expatrier, sans autre motif apparent que le besoin de changer d'air.
Mes fonctions de maire m'ont aidé dans cette recherche.
Souvent appelé à prêter mon ministère à ces émigrants, j'ai été admis à la connaissance de leurs affaires, à la confidence intimée des causes réelles de leurs déterminations.
Pour la plupart du temps, une gêne financière, un malaise général ignoré des autres, comprimé par un faux orgueil, en ont été la cause déterminante; mais souvent aussi l'influence de l'exemple en fut la seule.
Je n'ai jamais vu d'émigration isolée commencée par un individu ; elle a toujours été suivie de plusieurs autres. La contagion ne s'arrêtait pas à la même commune; elle gagnait autour d'elle de village en village, et, lorsqu'elle s'arrêtait, ce n'était que par intermittence et pour recommencer plus tard.
Les causes de cette maladie me sont connues ; je crois, Monsieur le Ministre, devoir vous les soumettre; elles vous expliqueront les raisons qui me font dire que le moment est venu de profiter des circonstances pour faire tourner au profit de l'Afrique des émigrants qui, jusqu'à ce jour, n'ont pas pris d'autre direction que celle de l'Amérique.
Je tâcherai d'être bref.
En aucun lieu du monde la propriété n'est aussi morcelée qu'en Alsace; les parcelles d'une contenance au-dessous de dix ares sont innombrables ; celles d'un hectare d'un seul tenant, faciles à compter.
Si ce morcellement a l'inconvénient d'augmenter les frais de culture, il a aussi l'avantage de permettre aux moins aisés d'avoir son coin de terre ; aussi l'Alsacien est-il essentiellement propriétaire, et tient-il à l'être partout.
Nos villages ne ressemblent en rien à ceux de l'intérieur de la France ; toutes les maisons en sont agglomérées. La ferme extérieure, avec ou sans cheptel, est inconnue dans ce département; le cultivateur est toujours propriétaire de l'un et de l'autre.
Une espèce de droit d'aînesse a de tout temps existé en Alsace et y existe encore ; la maison paternelle, le train de culture qui y est attaché, se transmettent toujours de père en fils, à un prix modique; avec eux suivent les biens détenus à bail.
Il s'ensuit que le frère aîné, devenu possesseur de la maison paternelle, est souvent un gros cultivateur, suivant qu'il a plus ou moins de biens à ferme, tandis que ses frères et sœurs ont déchu et se trouvent établis sur un pied bien inférieur.
C'est de la sorte que la grande culture s'est soutenue jusqu'à ce jour en Alsace.
Mais, depuis vingt ans, elle est battue en brèche ; elle chancelle aujourd'hui, et sera tôt ou tard anéantie.
La hausse du prix vénal des biens, devenue disproportionnée avec leur revenu, a déterminé les propriétaires à vendre.
Une quantité énorme de ces biens a quitté de la sorte l'état de biens à ferme, pour rentrer dans la masse des propriétés, après une division infinie.
Les maisons et bâtiments ruraux, construits pour les besoins d'une grande exploitation, sont restés les mêmes, tandis que les biens qui servaient à les utiliser ont diminué dans une proportion effrayante. Aussi, lorsqu'un cultivateur ne parvient pas, de son vivant, à transmettre sa maison et à y attacher quelques biens pour en soutenir l'exploitation, le jour de son décès marque celui de sa dislocation.
Le partage égal des biens entre tous les enfants, l'absence de biens à ferme, ne permettent à aucun d'eux de se charger d'un immeuble sans produit et sans utilité.
Tous étant pourvus, la vente en devient difficile, souvent même impossible ; ne restent plus alors que la vente et la démolition d'une partie des bâtiments, et la réduction du reste à de moindres proportions.
Ces explications, Monsieur le Ministre, ne soit point hors de propos ici, et vous allez voir qu'elles rentrent au contraire tout à fait dans le sujet que je traite; car il en résulte que la mise en circulation d'une aussi grande quantité de biens, restés longtemps entre les mains de familles qui les laissaient à bail, a forcé les agriculteurs à des acquisitions devenues onéreuses et souvent la cause de leur ruine, a rendu inutiles les grands bâtiments d'exploitation, par une réduction notable des terres qui y étaient attachées, et menace, par sa continuité, d'une ruine plus ou moins prochaine tous ceux qui ne subsistent plus que par le peu qui leur reste ;
Que le cultivateur se trouve endetté outre mesure et lutte avec peine contre les charges qui l'accablent ;
Qu'il règne enfin dans tout le pays un malaise général, qui prédispose singulièrement aux émigrations.
Cette cause n'est pas l'unique, car j'ai vu partir des familles entières qui n'étaient mues par aucune de celles que je spécifie.
Celles-ci poussées par un besoin de déplacement, le désir d'augmenter leur bien-être par un accroissement de propriété auquel elles ne pouvaient plus prétendre dans leur patrie.
La terre reste la même en présence d'un accroissement sensible de population ; bientôt elle manquera à ses bras et à ses besoins.
Les deux départements du Rhin ne se trouvent pas seuls dans cette position; nos voisins d'outre-Rhin, de la Bavière Rhénane, de la Suisse, souffrent également et, par d'autres causes peut-être, sont travaillés par la maladie d'émigrer.
Chaque année leurs nombreuses et immenses voitures, chargées de meubles, accompagnées de leurs familles, sillonnent nos contrées pour se rendre au Havre, et viennent réveiller chez nos cultivateurs les idées de suivre leur exemple.
Je n'ai pu rester impassible à de pareils évènements, dès que j'ai vu les progrès de la maladie ; je n'y ai pas cherché remède, je ne la pouvais pas; mais j'ai cherché à donner à ces émigrations une direction autre que celle de l'Amérique ; j'ai cherché à l'utiliser au profit de la mère-patrie.
J'ai demandé des terres aux contrées de la France qui en ont trop et manquent de bras ; mais, si j'ai trouvé d'immenses propriétés à acquérir ou à louer en entier, je n'ai trouvé nulle part de propriétaires qui connussent assez leurs intérêts pour se déterminer à vendre un tiers ou moitié de leur bien, pour faire produire au reste autant que leur rapportait la totalité auparavant.
Or, l'Alsacien, tenant avant tout à être propriétaire et non fermier, cette combinaison n'aurait pu marcher qu'en devenant l'objet d'une spéculation, ce que je ne voulais pas.
Mes vues se sont alors portées sur l'Afrique; ce pays seul m'offrait un débouché : dès 1834 je l'étudiais.
En 1836, je voyais à Paris Mr le Maréchal Clauzel, avec lequel j'étais en relation ; mais le moment n'était pas encore venu; l'ajournement fut décidé.
De 1836 à ce jour, j'ai été témoin de nombreuses et nouvelles émigrations, provoquées plus par un espoir vague d'amélioration que par la gêne. La maladie avait fait des progrès puisqu'elle agissait sur l'imagination de l'homme ; dès lors je crus le moment d'agir venu ; je m'adressai à vous, Monsieur le Ministre, pour m'aider sinon à la combattre du moins à l'utiliser.
Placé, comme je le suis, sur les frontières de l'Allemagne, de la Bavière et de la Suisse, dans un département disposé lui-même à l'émigration, je trouverai dans son sein et dans ses alentours des colons excellents cultivateurs, tels qu'il en faut à l'Algérie.
L'Alsacien, comme ses voisins, dont il parle la langue, ne reste pas indéfiniment attaché, comme le Français de l'intérieur, au sol qui l'a vu naître ; il le quitte plus facilement sans pour cela l'aimer moins, mais il trouve une patrie partout où il devient propriétaire d'un sol qui le paye de son travail, le nourrit et lui donne quelque aisance.
Il ne s'expatrie pas comme lui pour aller chercher fortune, la faire et revenir chez lui, aussi vite que possible, pour jouir de l'aisance qu'il a acquise.
Une fois parti, il lutte avec courage contre l'adversité, contre les obstacles ; il est persévérant, tenace, et lorsque ses efforts sont couronnés de succès, loin de songer à revenir, il s'attache encore plus au sol, il s'y identifie, il fait appel à ses amis et connaissances.
Ses belles qualités, comprimées par la gêne, se montrent alors dans tout leur éclat : il est obligeant, se fait le soutien, le conseil de ceux qui se sont rendus à son appel ; il les aide de sa bourse et de tout ce dont il peut disposer.
Généralement brave, disposé à l'état militaire, amateur du plaisir de la chasse, par conséquent accoutumé au maniement des armes, il fera un excellent milicien et ne craindra pas de défendre, les armes à la main, le foyer domestique, ni d'aller au secours de ses voisins.
Cultivateur pratique par excellence, il lui faut moins de temps qu'à un autre pour connaître le climat sous lequel il se réfugie, la nature du sol qui lui est confié, et pour savoir ce qui lui convient le mieux et ce qui peut lui rapporter le plus.
A force de peines et de travail, il rend fertiles les terres les plus ingrates, leur fait produire tout ce qu'elles peuvent donner ; actif, entreprenant, parfaitement entendu dans l'éducation des chevaux et des bestiaux en général, il est, sous tous ces rapports, le meilleur colon du monde.
Qu'on transporte cent de ces familles n'importe où, pourvu qu'elles aient des terres cultivables, des moyens d'exploitation, un débouché assuré à leurs produits : je garantis le succès, l'avenir du pays qu'elles auront adopté pour nouvelle patrie.
Avec de pareils éléments, si on sait soutenir la colonie à sa naissance, si on la couvre d'une protection active et entendue, l'Afrique, dans peu de temps, se suffira à elle-même, et bientôt redeviendra ce qu'elle fut dans l'antiquité, le grenier du monde.
En me mêlant de colonisation, j'ai eu deux buts : celui de changer la direction des émigrations en lui ouvrant un débouché qui assurât son avenir et ne privât pas la mère patrie de la ressource des connaissances pratiques et de la fortune des émigrants ; celui d'utiliser à cet effet notre nouvelle colonie et, d'onéreuse qu'elle a été jusqu'à présent, la rendre productrice et avantageuse.
Mais, je vous l'avouerai, Monsieur le Ministre, l'Amérique nous fera une rude concurrence : elle a aux yeux de nos cultivateurs des avantages marquants sur l'Afrique : d'abord la priorité, ensuite similitude de climat et sécurité complète.
En Afrique, au contraire, le climat, les produits du sol sont autres; c'est une nouvelle étude à faire pour nos cultivateurs; la sécurité n'étant point entièrement acquise, le colon aura des chances désagréables à courir, peut-être sa vie, ses nouveaux foyers à défendre.
Ces différences ont, jusqu'à ce jour, été un obstacle grave et ont empêché les Alsaciens de diriger leurs pas vers ces contrées; mais cet obstacle n'est pas insurmontable.
L'Alsacien n'a confiance qu'aux siens, qu'à ceux qu'il connaît de longue date, qu'à ceux qui peuvent parler par expérience; c'est pour être dans cette position, pour pouvoir répondre "de visu" à toute objection, pour pouvoir donner sur le sol et sur ses produits des renseignements positifs, que, de compagnie avec d'autres Alsaciens, j'ai fait le voyage d'exploration que vous avez ordonné.
Je puis aujourd'hui combattre avec avantage les prôneurs de l'Amérique, et je crois pouvoir affirmer que, guidés par un compatriote dans lequel ils sont habitués à mettre leur confiance, qu'ils ont vu quitter sa famille et ses affaires pour aller dans leur intérêt voir l'Afrique, y recueillir les renseignements dont ils ont besoin et qu'ils n'auraient jamais pu se procurer par eux-mêmes, qu'ils sauront avoir débattu et arrêté leurs intérêts avec le Gouvernement, avoir fait valoir leurs droits à sa protection et la leur avoir assurée.
Je puis affirmer, dis-je, que les Alsaciens et leurs voisins prendront la route de l'Algérie, de préférence à celle de l'Amérique, lorsque ce compatriote pourra en conscience leur dire : voici les conditions et les avantages que j'ai obtenus pour vous de l'Etat; c'est lui qui vous appelle, qui vous couvrira de sa protection, veillera à votre sécurité, favorisera le succès de vos établissements, et vous ne serez la pâture d'aucune espèce de spéculation; et c'est moi, que vous connaissez, qui suis allé en Afrique pour voir le pays exprès pour vous, moi qui pourrai soigner vos intérêts ici, vous protéger encore là, c'est moi qui vous conseille et vous engage à y aller.
Une intervention aussi directe et aussi précise de ma part aura certes de l'influence.
Je crois vous avoir démontré, Monsieur le Ministre, qu'il y a en Alsace prédisposition motivée pour l'émigration, et, d'après les explications que je viens d'avoir l'honneur de vous donner, vous reconnaîtrez avec moi qu'il y a deux espèces de colons à pourvoir : celui de moyenne fortune, qu'un malaise pousse à chercher une amélioration dans sa position; et les cadets de famille, qui, pour faciliter l'établissement de leur aîné, en se maintenant à un rang égal, s'expatrieront après être, au préalable, mariés dans des familles se trouvant dans une position identique à la leur. Leur fortune leur permettra d'emmener avec eux un domestique assez nombreux pour satisfaire aux besoins des exploitations qu'ils voudront fonder.
J'ai des vues particulières sur chacun de ces colons, je les émettrai à leurs places respectives.
A présent, Monsieur le Ministre, que j'ai eu l'honneur de vous faire connaître comment il se fait que je m'occupe de colonisation, et quels sont les éléments que j'ai à l'entour de moi, j'arrive à mon rapport sur mon voyage d'exploration.
RAPPORT.
Je suis parti de Strasbourg, avec mes huit compagnons de voyage, sans avoir pu connaître l'époque de départ des paquebots de l'Etat.
Arrivé à Toulon le 27 décembre, à onze heures du soir, j'appris qu'il y avait un départ pour l'Afrique le lendemain.
A la pointe du jour, je me rendis chez M. le sous-intendant, pour faire régulariser notre embarquement. Il était déjà au port, et, lorsque je parvins à l'approcher, il était trop tard, le bâtiment était parti; huit jours de séjour forcé à Toulon nous furent imposés par cette circonstance.
Embarqués sur "La Chimère" le 3 janvier, nous sommes arrivés à Alger le 7 au soir.
Pendant mon séjour dans cette province, j'ai parcouru le Sahel dans tous les sens, de la mer à la plaine, de Fouka et Koléah à la Maison-Carrée et la plaine, autant que le temps et la prudence me l'ont permis.
J'ai vu les villages commencés et l'emplacement de tous ceux projetés. M. le gouverneur général et M. le directeur de l'intérieur m'ont, l'un et l'autre, communiqué leurs idées sur la colonie.
J'ai observé, de près et en détail, la population actuelle répandue dans le massif, la nature et l'espèce des ouvriers et soi-disant colons débarqués chaque semaine à Alger.
Ce qui existe en ce moment de culture, ce qu'on peut espérer du sol avec une population active, vigilante et véritablement agricole.
Enfin, j'en ai assez vu, assez appris pour me former une idée exacte du pays, de ses ressources, de ses besoins, du parti qu'on peut en retirer, et de ce qu'il faut de toute nécessité faire pour établir la colonie sur des bases solides et la mettre en voie de prospérité.
Après avoir achevé mon exploration dans l'Algérie, je me suis rendu à Bône, dont j'ai visité le territoire. Chemin faisant, en allant et en revenant, je me suis arrêté à Philippeville, dont j'ai visité les environs, ainsi qu'à tous les points de la côte où nous avons des étalissements.
Je traiterai la question de Bône et de Philippeville séparément de celle d'Alger.
ALGERIE.
Dans le massif, les Arabes sont peu à redouter le jour, et, avec des précautions et de la prudence, on peut se mettre à l'abri de leurs attaques nocturnes.
L'achèvement de l'obstacle diminuera leurs incursions, une population compacte et vigilante fera le reste.
Fouka, situé à quelques centaines de pas du pays des Hadjoutes, tribu redoutable sous tous les rapports, devra être longtemps encore tenu sur un pied respectable de défense : ce village touche à l'obstacle et deviendra le but les principales attaques des Arabes; il devra couvrir le reste du massif.
Mais, Monsieur le Ministre, si pour la colonie à fonder je redoute peu les Arabes pour l'avenir, il n'en est pas de même de ce ramassis d'étrangers venus de toutes les parties du monde pour inonder l'Algérie.
Pour activer les travaux entrepris, on a fait appel à tous les bras oisifs de l'Europe; chaque puissance, chaque localité a profité de l'occasion pour se débarrasser de ce qu'elle avait de mauvais, d'impur.
A l'indemnité accordée par l'Etat, on en a ajouté une autre, pour décider au départ des gens qui embarrassaient, dont on ne savait que faire.
Ces soi-disant colons, je les ai vus, entendu raisonner, se plaindre de déceptions; ils entendaient venir en Afrique comme en pays conquis, pouvoir s'y livrer à leurs débordements, y vivre dans l'oisiveté et dans la débauche.
Malgré la surveillance active dont ils sont l'objet, ils quittent les travaux dès qu'ils ont fait quelques économies, et se répandent dans le massif.
La douceur du climat leur permet de coucher dans les champs; partout où il y a une maison, il y a un cabaret, du vin à bon marché; dès que leurs ressources sont épuisées, ils se livrent au vol et au pillage, le travail leur étant antipathique.
Sur les assassinats qui se commettent encore journellement dans ce pays, et qu'on a l'habitude d'attribuer aux Arabes, on peut, sans se tromper, leur en attribuer une bonne part. Aujourd'hui cependant tout homme de bonne volonté trouve de l'ouvrage et gagne un honnête salaire. Que sera-ce lorsque les travaux diminueront ou lorsqu'ils cesseront ?
Je crois que des mesures devraient être prises pour faire cesser ces arrivages de gens sans aveu, qui sont déjà un embarras, et qui le deviendront tous les jours plus.
Quant aux habitants des différents villages fondés, ils sont tous débitants; aucun d'eux ne se livre à l'agriculture; leur oisiveté, leur genre de vie sont d'un mauvais exemple; j'en redoute le voisinage et le contact, et, à cause d'eux, je demande séparation complète.
La plaine de la Mitidja est sans contredit ce qu'il y a de mieux dans l'Algérie; mais outre qu'elle est malsaine, pas sûre du tout et presque tout entière en dehors de l'obstacle, qui, à mon avis, aurait dû être porté au pied de l'Atlas, on ne peut sans danger penser à l'utiliser aujourd'hui; elle est réservée à l'avenir.
Le massif est composé de vallons resserrés entre des montagnes escarpées, sans être élevées, avec quelques échappées de plaines vers la mer et vers le Mitidja; le sol en est pierreux, partout recouvert de fortes et épaisses broussailles; pour être mis en culture, il exige des défrichements longs et pénibles, de grands travaux, de l'argent.
La sécurité n'étant point complète, le colon ne devra jamais sortir sans son fusil, sans laisser une garde dans le village, sans faire veiller ses troupeaux; en un mot, il devra être continuellement sur le qui-vive.
Si ensuite il peut se mettre en sécurité, lui, sa famille et ses troupeaux, derrière l'enceinte de son village, ses récoltes n'en resteront pas moins exposées aux ravages des Arabes; il courra donc la chance de voir anéantir, en un jour ou une nuit, l'espoir de toute une année.
En présence de pareilles éventualités, de dangers certains, il faut leur faire des avantages assez grands pour qu'ils affrontent ce danger, s'exposent à ces chances.
En général, le sol, moins fertile que celui de la plaine, n'en est pas moins propre à toute espèce de culture; avec du temps et du travail on en fera quelque chose.
Voulant opérer en dehors de tout ce qui a été commencé, isoler l'exécution de mon système pour en faire ressortir la supériorité sur tous les autres, je m'abstiendrai de parler de ce qui existe, de signaler les causes qui s'opposent à un plus grand développement, et je ne m'occuperai que de fondations nouvelles.
La première chose à faire, c'est d'ouvrir des voies de communication aux communes qu'on projette : on s'en occupe, mais il faut activer ces travaux, il faut établir les fossés d'enceinte de chacune d'elles, construire les bâtiments publics qui doivent servir d'asile provisoire aux premiers colons envoyés sur place pour construire le village ;
Lever le plan de la commune et de sa banlieue, faire connaître exactement la contenance à donner à chaque emplacement de maison ;
Désigner sur les plans les terrains propres à la culture des céréales, à l'établissement des prairies naturelles, à des plantations d'arbres.
Faire la division de chaque nature de terrain en autant de lots que la commune devra contenir de feux; en un mot, il faut que tout soit prêt, et que le colon n'ait plus qu'à prendre possession et se mettre à sa charrue.
Ce qu'il faut essentiellement éviter pour les nouveaux arrivants, c'est un séjour forcé à Alger, une oisiveté prolongée : l'un les induirait en dépenses et diminuerait leurs ressources ; l'autre leur ferait contracter de mauvaises habitudes ou les porterait à l'ennui et au dégoût.
Plusieurs systèmes sont en présence; ils sont tous le résultat d'excellentes intentions, mais, basés exclusivement sur la théorie, je dois dire que, suivis isolément, ils n'auront pas le moindre succès.
En fait de culture, et surtout de colonisation dans un pays neuf, manquant de bras et de matières premières, la théorie n'est rien; il faut une grande connaissance des besoins de l'agriculture pour apprécier la nécessité de lui faire certains avantages qui la fixent au sol en lui permettant de prospérer.
Pour réussir, il faut, en premier lieu, coloniser avec de véritables cultivateurs et non avec des gens qui en usurpent le titre. Construire un village, le peupler de soldats libérés qui n'ont peut-être jamais su ce que c'est que l'agriculture, ou qui pendant la durée de leur service on ont perdu l'habitude, et espérer qu'il prospère, c'est espérer l'impossible.
Etablir des voies de communication, des enceintes de villages, construire par-ci par-là les établissements publics, peupler le tout sans choix et avec les premiers venus, sans faire plus, c'est espérer encore avec moins de chances.
Tous ces systèmes sont d'avenir; j'y vise, mais ils ne sont pas praticables aujourd'hui.
Il ne faut pas se le dissimuler, pour commencer, et j'entends par là commencer avec certitude de succès, il faut que le colon, abrité, pourvu des objets de première nécessité, pour prospérer, n'ait point encore épuisé toutes ses ressources.
Or, il faut renoncer à l'avenir de la colonie, à son succès, ou faire prospérer ce commencement : de lui dépend tout l'avenir de la colonisation.
Il ne s'agit pas, au cas particulier, de vouloir faire de l'économie en pure perte, mais de faire une dépense utile, de la faire à propos et avec des vues d'avenir; c'est ainsi que j'envisage la question, ainsi que je vais prendre la liberté de la traiter.
Système que je propose de suivre.
Parmi les communes projetées, j'accorde la préférence à celles qui se trouvent sur le versant nord du massif, vers la mer; j'y comprends Fouka, si Monsieur le Gouverneur général veut admettre mon concours.
Eu égard à la conformation du terrain, je suppose que le territoire de chaque commune ne pourra se composer que de 3 à 400 hectares de terres cultivables; je puis me charger d'en peupler 6 ou 7 dans un délai donné.
En le faisant, je veux faire retrouver aux colons leurs anciens foyers domestiques; à cet effet, leur laisser la faculté de remplacer par des noms à eux connus les noms barbares donnés à chaque commune dans le pays.
Pour la même commune, prendre des colons de la même religion, dans le même pays, et, autant que faire se pourra, dans un rayon assez peu étendu pour qu'ils puissent se connaître ou au moins faire connaissance ensemble avant leur départ; leur donner pour une ou deux communes, selon leur importance, un ecclésiastique de leur choix, de leur pays, parlant leur langue; les faire précéder en Afrique, pour activer les premiers travaux, par un homme à eux connu, ayant leur confiance, qui devra les recevoir à leur arrivée, les conduire à leur destination, leur procurer ce dont ils auront besoin, et les mettre continuellement à l'abri de la fraude et de la duperie.
En un mot, faire qu'en arrivant en Afrique, ils se retrouvent en pays de connaissance et comme chez eux.
En opérant ainsi, je préviens l'ennui, le dégoût et je rends la nostalgie impossible.
Je réclame tout d'abord et préalablement la mise à exécution du système de M. le Directeur de l'Intérieur dans son entier : il fera les chemins, l'enceinte d'un premier village, le pourvoira de ses bâtiments publics, de ses fontaines, fera défricher un tiers au moins de son territoire.
Ces travaux préparatoires faits, j'expédierai pour cette commune le nombre de colons qui pourra y trouver asile.
Ce nombre sera composé, dans de justes proportions, de tous les états et métiers nécessaires pour que le village puisse être construit sans concours étranger, et assez de terres cultivées pour que, dès la première année, la récolte suffise à la nourriture de ses habitants.
Le reste des colons sera envoyé au fur et à mesure que les maisons seront en état de les recevoir, de manière à ce qu'ils ne soient jamais exposés à se trouver sans abri et à ne savoir où mettre leurs effets.
Pour opérer méthodiquement, n'avoir point d'encombrement, et amener, petit à petit, "une baisse dans la main d'œuvre, en ce moment hors de prix" en Afrique, je désignerai cette première commune à entreprendre; elle sera autant que possible, au centre des autres, et dès que je connaîtrai la contenance de son territoire, le nombre de feux qu'elle devra contenir, et pendant qu'on en fera l'enceinte, pendant que l'on construira les édifices publics destinés à servir de premier abri aux colons, je recruterai, de mon côté, les gens de métier et les cultivateurs qui devront la peupler, pour ensuite en faire l'envoi, au fur et à mesure du besoin.
Cette première commune faite et peuplée avec discernement, ses habitants se mettront à la construction de la seconde, pendant que j'en recruterai la population. Marchant ainsi de commune à commune, j'atteindrai, avec le moins de frais possible, le but que je me propose.
Ces communes se connaîtront à l'avance, et par leurs noms et par leurs habitants; elles s'entre-aideront, feront un échange continuel de services réciproques. Pendant que les ouvriers seront occupés aux constructions des maisons des cultivateurs, ces derniers cultiveront et ensemenceront les champs des ouvriers, et ainsi de suite.
Les premiers travaux seront pénibles et dispendieux ; mais, au fur et à mesure qu'on avancera et qu'on peuplera, la charge diminuera dans la même progression.
Chacun devant être responsable de ses œuvres, je veux l'être de la mienne, tant à l'égard de l'Etat qu'à l'égard des colons; mais alors je demande :
Qu'on me fournisse le plan exact de chaque commune, de sa banlieue, avec indication de la contenance de chaque emplacement de maison, de chaque nature de terrain, avec division en autant de lots que de feux ;
Que l'on m'accorde, à moi seul, le droit d'admettre le colon qui devra faire partie du village, de lui désigner l'emplacement de sa maison, les lots de chaque nature de terrain qui devront en faire partie, et leur contenance.
J'ai besoin d'avoir ce droit pour ne pas être exposé à de mauvais choix, à des mélanges dangereux, pour donner à chacun selon ses ressources personnelles, selon l'importance de sa famille, surtout encore pour éviter les inconvénients d'un double emploi dans les concessions.
Je serai, de plus, chargé de fixer les départs. M. le commandant du port de Toulon, M. le directeur de l'intérieur à Alger seront l'un et l'autre prévenus à temps de l'arrivée des colons et de leur nombre. Leur embarquement sera dès lors arrêté à jours fixes; ils ne seront pas mis dans le cas de séjourner pendant huit jours à Toulon, ni d'y manger leur argent.
Des mesures devront être prises à Alger, par M. le directeur de l'intérieur, pour que, à leur arrivée, ils puissent être immédiatement transportés, eux, et leurs effets, à destination.
Voici à présent ce que je réclame pour eux :
Le colon admis aura, sur un bâtiment de l'Etat, passage gratuit pour lui, sa famille, ses effets et ses approvisionnements, jusqu'à concurrence d'un poids déterminé, à raison du nombre des membres qui en font partie.
A son arrivée à Alger, il lui sera fourni des moyens de transport gratuit pour le tout, jusqu'à sa destination.
Il sera fait à chacun concession gratuite de l'emplacement de sa maison, et d'un jardin, s'il en est établi dans l'intérieur de la commune.
Concession, à titre onéreux, de biens ruraux dans les proportions que j'aurai indiquées. Le prix de cette dernière concession sera déterminé à l'avance, soit à un capital payable à termes, soit à une redevance annuelle par hectare, perpétuellement rachetable à un denier convenu.
Il sera affranchi de toute redevance et de tout impôt sur la totalité de la concession, pendant cinq ans.
A partir et y compris la sixième année, la redevance et les impôts seront exigibles sur la moitié, quelle que soit la partie mise en culture, et sur la totalité à partir de la onzième.
L'Etat restera chargé du transport sur place des matériaux de construction achetés à Alger, pour la première commune : celle-ci une fois construite, il y établira des entrepôts ou les autres viendront s'approvisionner. Cette charge cessera pour lui aussitôt que le pays présentera par lui-même assez de ressources pour que ce transport puisse être exécuté sans trop de grands frais.
Mais ce n'est pas tout, je demande encore quelque chose :
A l'exemple de mes devanciers, j'aurais pu demander, pour ces colons, une avance remboursable à termes plus ou moins éloignés; mais, pour moi, le nom ne fait rien à la chose, et j'aborde hardiment une question nouvelle et qui, je le sais, éprouvera une forte opposition.
Ce n'est pas une demande que je demande, c'est un don ; je le crois nécessaire à la réussite, plus encore pour faire prendre à l'émigration la route de l'Algérie, qui n'a pas encore été la sienne.
Mais, Monsieur le Ministre, veuillez ne vous effrayer ni du mot ni de la chose, et m'écouter encore un instant.
Le don d'une somme restreinte qui peut procurer d'immenses avantages est, à mon avis, préférable à des avances sans fin qui peuvent n'en procurer que fort peu et coûter beaucoup plus.
Expliquons notre pensée.
Le système d'une avance allèchera bien des gens, mais Dieu sait quels gens ! Des colons obérés, qui sortiront de la gêne par une porte pour y rentrer par une autre; arrivés sur les lieux, ils y vivront tant bien que mal des avances qu'on leur aura faites, et, lorsque approchera l'époque du remboursement, je craindrais de les voir se disséminer et abandonner leurs établissements pour s'y soustraire : l'Etat n'aura donc alors que peu ou pas de moyens de rentrer dans ses avances; c'est donc, en définitive, un don présenté sous une autre forme.
Avec le système des avances, mon choix se trouvera nécessairement restreint; je n'aurai que des colons obérés, qui s'accrocheront à l'avance comme à une branche de salut, sans présenter des garanties positives d'avenir, et, je le déclare hautement, ce n'est pas avec de pareils éléments que je voudrais fonder la base de la colonie : je le répète, l'Amérique est là, qui aura toujours la préférence des gens à capitaux, et ce sont ceux-ci que je voudrais lui enlever pour amener à bonne fin le projet que je médite.
Pour y parvenir il faut nécessairement leur offrir des avantages réels marquants.
Ce ne sera certes jamais pour une route, une enceinte et des terres que celles qu'on peut leur offrir, et qui n'ont au moment actuel aucune valeur, qu'ils s'expatrieront pour aller risquer leur vie, leur fortune, ni enfin pour une avance remboursable.
Si ce colon est solvable, s'il peut rembourser, il n'acceptera pas cette offre; s'il l'accepte, sa solvabilité sera douteuse, et le capital avancé pourra se trouver compromis.
Avec le système des avances vous marcherez lentement, mal, et vous ne saurez jamais quand vous vous arrêterez; recrutant à la même source, tous vos colons demanderont des avances et vous forceront, soit à arrêter l'élan en les suspendant, soit à dépasser vos prévisions primitives.
En vous réclamant un don, loin de charges les finances de l'Etat, de l'entraîner à des dépenses sans bornes, je prétends dégrever les unes, restreindre les autres, et peut-être les fixer à un chiffre beaucoup au-dessous de ce que vous présumez.
J'ai eu l'honneur de vous dire plus haut, Monsieur le Ministre, que le succès de la colonisation dépendait, avant tout, des éléments employés à son commencement, j'y ajouterai :
Pour avoir de bons éléments, commencez à combattre, à force d'avantages, la propension du pays à aller en Amérique; faites-en de tels qu'en peu de temps trois ou quatre cents bonnes familles prennent la route de l'Afrique; faites qu'elles puissent y prospérer, qu'elles puissent donner de bonnes, d'excellentes nouvelles, et votre procès est gagné.
L'Afrique, connue et appréciée, devient alors préférable à l'Amérique; elle est plus rapprochée et tout aussi fertile, et le torrent change de direction : il se jette sur ce beau pays, les véritables colons affluent; votre devoir est rempli, vous ne devez plus que votre protection.
La seule chose enfin qu'il faut, c'est de prouver jusqu'à l'évidence que le pays est bon, que son sol récompense largement les soins qu'on lui donne. Cette preuve acquise, soyez tranquille, on ne vous demandera ni dons ni avance, pas plus qu'on en demande aujourd'hui à l'Amérique.
Mais traduisons ma pensée en chiffres.
Les six ou sept communes que j'ai en vue comporteront trois ou quatre cent feux au plus, à cause de l'exiguïté de leur territoire cultivable; les colons n'en pourront être recrutés "que dans la classe moyenne", celle en faveur de laquelle j'élève la voix, parce que c'est elle qui donnera l'élan, elle qui fera connaître le pays et décidera, plus tard, ceux qui craignent encore de s'aventurer.
Destinez à ces trois ou quatre cents familles un fond d'un million à douze cents mille francs; que ce fonds soit employé avec discernement, je pose en fait que s'arrêtera le sacrifice : que ces sept communes soient mises en voie de prospérité, la colonisation marchera toute seule; on ne vous demandera plus rien.
En vous engageant, Monsieur le Ministre, à destiner un fonds quelconque à un commencement de colonisation, n'allez pas croire que ce soit pour en avoir l'administration, y puiser des bénéfices illicites; non : ce fonds, c'est l'Etat qui en fera la distribution, c'est lui qui en surveillera l'emploi, je resterai tout à fait étranger à sa manipulation.
Si ma proposition était agréée, je n'indiquerai que la somme à allouer à chaque colon : elle ne lui serait point remise en espèces ; mais l'Etat payerait pour lui ses matériaux de construction, ses ouvriers, ses achats de bestiaux, de semences, etc., le tout exclusivement employé à l'amélioration de l'établissement fondé.
Si je demande à être chargé de la répartition des terres et du fonds commun, c'est que, l'égalité entre tous étant une utopie, il ne faudra pas l'introduire : chacun n'aura en terres que ce qu'il pourra raisonnablement exploiter, et en fonds que ce qu'il lui faudra pour pouvoir prospérer.
Ensuite, pour ne pas m'écarter de mon système et fonder la première commune avec les meilleurs éléments possibles, je suis d'avis de faire aux 50 ou 60 premiers colons, pour les décider et leur faire prendre cette route nouvelle pour eux, des avantages plus grands que pour les colons de la seconde; à ceux de la seconde des avantages plus grands qu'à ceux de la troisième, et ainsi de suite.
Le principal est de bien commencer, le reste s'ensuivra, et peut-être la dépense pourra-t-elle être réduite bien plus vite que je ne le suppose moi-même.
Je propose de laisser au colon le soin de construire sa maison plutôt que d'en charger l'Etat; d'abord, parce que je crois qu'il construira à meilleur marché que lui ; ensuite parce qu'en la construisant lui-même, il la fera selon son goût et s'y attachera.
Je demande que l'Etat fasse les transports sur place, parce qu'en ce moment, ce serait chose impossible en Algérie à un colon; les frais de transports, s'il était obligé de les payer, quadruplerait peut-être le prix de revient de ses matériaux.
Cette charge, du reste, ne sera que momentanée : une ou deux communes construites, les voies de communication ouvertes, les colons pourront y pourvoir eux-mêmes; mais, quant à présent, il ne faut pas se le dissimuler, il y aurait impossibilité physique de le faire ; ce serait, dès le début, le condamner à sa perte.
J'ai dit quelque part que la colonie naissante devra être couverte d'une protection active et intelligente : il en est une qui ne lui manquera pas, c'est la protection matérielle ;
Mais je veux plus, je demande qu'on assure l'écoulement de ses produits, c'est le premier élément de succès : en conséquence, que l'Etat prenne à la colonie ses excédents en tout genre pour le service de ses troupes ; qu'à égalité de prix et de qualité, il leur donne la préférence à tous autres et ne s'adresse au dehors qu'après avoir épuisé les réserves intérieures.
Si les conditions que je présente, les avantages que je réclame pour les colons étaient admis, je ne recevrais comme tels que des gens bien famés, ayant des ressources particulières, et alors j'accorderais à l'Etat un droit de contrôle sur leur emploi; j'exigerais de chaque colon qu'après le prélèvement du strict nécessaire pour son voyage et ses premiers frais d'établissement, avant la remise de son permis d'embarquement et la réception de son acte de concession, il versât dans les caisses de l'Etat l'excédent de ses ressources; et c'est sur l'emploi de cet excédent que j'accorde un droit de contrôle à l'Etat.
Mais, me répondra-t-on, c'est mettre un homme en tutelle ; l'Etat n'a pas ce droit : la réponse est facile. L'Etat fera de cette obligation une condition de son don ; faisant un sacrifice pour fonder une bonne colonie, il a le droit d'en stipuler les conditions; voulant sa prospérité, il a le droit de surveiller l'emploi des ressources dont elle peut disposer. Ceci ne peut faire question.
Par ce moyen, je mets sous la sauvegarde de l'Etat toute la fortune pécuniaire de la colonie naissante et en fais la garantie qu'il a le droit d'exiger; je force le colon à l'ordre, à l'économie, à un bon emploi de ses ressources.
Mais, pour obvier à toute objection et ne contraindre personne, j'accorde à tout colon la faculté de se soustraire à cette surveillance, en renonçant au fonds commun, ou en remboursant à l'Etat ce qu'il pourra en avoir reçu.
Quoique je sois partisan bien prononcé d'un sacrifice une fois fait, plutôt que d'un système d'avances remboursables, je ne rejette point tout à fait l'emploi de ce dernier ; et, si mon opinion devait éprouver un refus, j'aviserais aux moyens de combiner mes idées avec l'emploi de ce système.
Je suis forcé, Monsieur le Ministre, de me répéter encore : je ne me dissimule point toutes les difficultés que mon opinion doit rencontrer; mais, parlant par conviction, avec une connaissance parfaite des moyens qu'il faut employer pour changer la propension du pays, j'ai pensé qu'il était de mon devoir de vous parler avec la plus grande franchise, et de vous exposer sans la moindre restriction mes idées sur la manière la plus sûre et la plus économique de parvenir à la colonisation de l'Afrique.
J'aborde à présent la question de Bône
Bône.
Le territoire de cette ville présente des plaines plus accessibles à la grande culture ; il y a beaucoup de prairies naturelles ; on peut les augmenter encore. Le terrain n'est pas comme à Alger, couvert de broussailles; il est au contraire annuellement cultivé par les Arabes ; la sécurité est parfaite ; là, plus de terre, moins de peine pour en tirer des produits, inutilité de former des villages serrés ; au contraire, facilité de fonder de grandes exploitations avec une ferme au centre.
La plaine de Safsaf, derrière Philippeville, présente les mêmes avantages.
On peut, aux abords de l'une et l'autre de ces villes, former des établissements sans crainte. Les fondateurs seront reçus à bras ouverts par les autorités et les gros propriétaires de ces contrées, disposés à les protéger et à les soutenir.
Dans le préambule de mon rapport, j'ai eu le privilège de vous dire que je comptais sur deux espèces de colons : celui de la classe moyenne, que je destine à la province d'Alger, et celui de la classe riche, le fils de famille, que je destine aux territoires de Bône et de Philippeville.
Je viens de traiter la question qui concerne le premier, je vais traiter celle qui concerne l'autre.
Si, dans la province de Constantine, le fils de famille peut être satisfait, sous le rapport de la quantité et de la qualité des terres qu'on pourra lui donner, moins aventureux que le colon de la moyenne classe, il craindra encore d'exposer sa fortune, car celui-ci en a.
Cette crainte est un obstacle que j'entrevois les moyens de lever ; à lui, il ne faut pas de dons, pas d'avances, mais, pour le décider à s'expatrier, il faut lui offrir une garantie d'avenir ; cette garantie, voici comment je la formule.
Le colon aisé qui voudra aller fonder un établissement dans l'un ou l'autre de ces parages sera autorisé à verser dans les caisses de l'Etat toutes les ressources qu'il voudra y employer.
Arrivé sur les lieux, l'Etat lui fera, jusqu'à concurrence de son dépôt, les avances dont il aura besoin ; il y aura entre l'Etat et lui compensation d'intérêts jusqu'à due concurrence ; il lui sera tenu compte de ceux produits par l'excédent ; il sera exempt d'impôts et de redevance pendant cinq ans ; à l'expiration de ce terme, il sera autorisé à payer le prix de la concession qui lui aura été faite, soit en payant la redevance annuelle convenue, soit en payant comptant ou à termes le capital de cette même redevance.
Si dans un délai de dix ans, la colonie, pour une cause quelconque, devait être abandonnée, que, pour cette raison, le colon ne voulût plus rester, l'Etat aura à lui restituer intégralement son dépôt, sauf à disposer à son profit de l'établissement abandonné.
Passé dix ans et jusqu'à vingt, il n'aura plus à lui restituer que les capitaux payés pour l'amortissement de la redevance de concession, et passé vingt ans, plus rien du tout.
J'échelonne ainsi la garantie que je réclame, parce que je suppose que le colon aura pu économiser au bout de dix ans les frais de son premier établissement, et au bout de vingt le prix de la concession.
Je considère la garantie demandée à l'Etat comme étant sans conséquence pour lui, parce que l'abandon n'entre pas dans ses vues, n'est pas possible, et le sera bien moins lorsque la colonie sera une fois productive.
Mais, si elle est sans conséquence pour lui, elle est des plus importantes pour le colon ; en effet, lorsqu'on lui dira : il vous répugne d'aller fonder un établissement agricole dans la province de Constantine parce que vous craignez d'aventurer vos fonds, de les exposer aux chances d'une guerre qui nécessiterait l'abandon ; eh bien ! pour vous ôter jusqu'à l'ombre de la moindre crainte, l'Etat, outre les concessions qu'il vous offre, vous garantira pendant dix ans les fonds que vous aurez mis à fonder votre établissement, et pendant vingt ceux que vous auriez payés pour prix des concessions.
A cela plus d'objection possible, et, avec de telles conditions, il se décidera.
Quant aux avances à faire, elles ne nécessitent aucun crédit, aucune avance de fonds ; l'Etat reçoit d'une main des sommes plus ou moins importantes, il les donne de l'autre en moindre quantité, et, dans aucun cas, en quantité supérieure.
Quant à l'obligation de restituer dans un certain délai, dans la prévision d'un cas de force majeure, elle est juste.
Faisant appel à ses enfants, les engageant à porter leur industrie et leur argent dans une nouvelle patrie qu'ils sont destinés à rendre productive, il est équitable qu'il leur rende leur mise de fonds, si, par une circonstance malheureuse, ils se trouvent dans la nécessité d'abandonner leurs établissements.
J'ajouterai que je restreins cette garantie aux colons régnicoles, et encore seulement aux premiers qui se rendront à l'appel qui leur aura été fait et, par exemple, détermineront les autres ; car, encore une fois, il ne s'agit pas ici, comme pour l'Algérie, que d'un commencement qu'il faut faire prospérer, coûte que coûte.
Par exemple, je réclamerai pour ce colon, comme je l'ai fait pour l'autre, passage gratuit sur un bâtiment de l'Etat pour lui, sa famille et ses effets, et préférence continuelle pour ses produits agricoles pour les besoins des troupes entretenues en Afrique.
Il ne faut pas que le colon voie venir du dehors des grains et des fourrages, pendant qu'il s'en voit encombré lui-même : ce serait étouffer, dès le principe, le germe de la prospérité de l'agriculteur, son seul stimulant, la certitude de voir écouler ses produits.
L'Etat, d'ailleurs, trouvera un avantage certain à s'approvisionner auprès d'eux plutôt que d'avoir recours aux provenances de l'extérieur.
Je n'ose me flatter, Monsieur le Ministre, de voir mon système adopté dans son entier ; mais, si on veut bien l'étudier, le comparer avec ceux qu'on a suivi jusqu'à ce jour, consulter les personnes qui ont, par devers elles, des connaissances pratiques en agriculture, celles qui, comme dans l'intérieur de la France, sont dans le cas, pour se procurer des fermiers, de leur fournir bâtiments, cheptels et souvent encore de leur faire des avances pécuniaires, on reconnaîtra alors, dis-je, que je suis resté dans le vrai et ne demande que le strict nécessaire pour coloniser avec espoir de succès.
J'ai reconnu dans l'Algérie des éléments de prospérité immenses, mais je ne me suis pas dissimulé les difficultés de la mise à exécution; c'est sur elle que je base mes demandes.
J'ai la profonde conviction que mon système, que je conçois mieux que je ne l'expose, obtiendra tout le succès que je fais entrevoir, s'il est mis à exécution avec le discernement qu'il réclame.
Il permet enfin d'en faire l'essai sur une moins grande échelle que celle que j'indique, puisqu'on peut en faire l'application à une première commune et juger de son effet par le résultat de ce premier essai.
Je désire, Monsieur le Ministre, avoir satisfait à la mission que vous m'aviez confiée, et je réclame toute votre indulgence pour la manière dont je vous présente le résultat.
J'ai l'honneur d'être, etc.
Signé : ACHARD.
Notaire, Maire de Hochfelden et membre du Conseil général du département du Bas-Rhin.
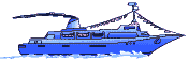 Retour au menu "composantes"
Retour au menu "composantes"