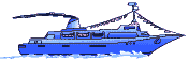 Retour au menu "et après"
Retour au menu "et après"
On ne connaissait pas ça, nous, le verglas. Ni la neige, d'ailleurs. En fait, on ne connaissait pas le froid. Le vrai froid. Celui qui te gèle les os, t'engourdit les mains, te brûle les oreilles, te fait claquer les dents. À Alger, en dessous de dix degrés, on mettait un manteau. Ici, à Rouen, en ce mois de décembre 1962, il fait moins quinze ! C'est un hiver polaire. Partout en France, le mercure oscille de moins dix à moins vingt-cinq. De nombreux ports sont paralysés par des banquises, les fleuves et les rivières charrient des blocs de glace. J'ai rajouté des semelles en carton dans mes godillots pour isoler mes pieds du sol gelé. Je porte un duffle-coat usé et des gants de laine rêche offerts par la Croix-Rouge. J'avance en funambule sur les pavés disjoints. À l'extérieur de la ville, tout est figé au travers d'un brouillard blanchâtre. Les baraquements aux toits de tôle du centre d'hébergement des rapatriés ont l'aspect sinistre d'un goulag. Des familles d'une communauté gitane d'Algérie y sont entassées depuis l'été. J'ai grimpé jusqu'ici pour rencontrer Manolo, un joueur de guitare. On m'a dit qu'il vivait au bâtiment numéro 4. À l'entrée des habitations, trois gamins alimentent un brasero avec le contenu d'une poubelle. De maigres flammes bleues s'échappent d'une vieille lessiveuse percée de trous semblables à des impacts de balles de gros calibre. Les jeunes garçons ont le visage protégé par de larges écharpes taillées dans une couverture grise. Ils flottent dans des manteaux trop grands et sont coiffés de bonnets de laine. Je ne vois que leurs yeux mi-clos, des regards noirs qui m'observent avec méfiance. Je me rapproche d'eux et leur lance, sur un ton complice, en posant mes mains au-dessus de ce feu de misère : " Ça, c'est une bonne idée ! Mais ça ne remplacera jamais notre soleil ! " Ont-ils entendu que j'étais d'Alger ? Peut-être pas. Les enfants pieds-noirs ont appris à garder les oreilles sourdes et la bouche muette. Moins on en dit, mieux on se porte. C'est la leçon des aînés. Question de sauvegarde. Pas la peine d'insister, ils ne me répondront pas. Je reste près d'eux. Je grelotte, les pieds enfoncés dans la neige. Ils sont devant moi, en demi-cercle. Absents. Ils doivent avoir une dizaine d'années. C'est l'âge de mon frère. Lui aussi parle peu. Les médecins de Rouen qualifient ce mutisme de choc émotionnel. Beaucoup de pré-ados rapatriés d'Algérie en sont victimes. Dans de nombreuses écoles, ils subissent les remarques allusives de certains profs politisés. En cours de récré, ils sont mis à l'index et raillés pour leur accent. Ça castagne dur, parfois. Les punitions tombent, assorties de commentaires blessants sur leur origine et leurs manières. Ceux qui représentaient les soixante-douze pour cent de la population française d'Algérie dont le niveau de vie était de dix à quinze pour cent inférieur à celui des Français de métropole. Les modestes et les pauvres le sont davantage qu'hier. Les riches et les aisés le sont beaucoup moins que demain. Le blizzard s'est levé. Il balaye les flammes du brasero, fouette nos visages, efface le paysage. Sans un mot ni un regard, les trois gamins s'en vont d'un pas lourd, le dos plié, les épaules rentrées. Ils se tiennent par la main et disparaissent dans les tourbillons de poudreuse. Je renonce à les suivre et je me dirige vers le seul bâtiment que la tempête de neige me permet encore d'entrevoir. Je frappe en poussant la porte sans attendre une réponse : il fait trop froid. La pièce est un assemblage de cloisons préfabriquées au plafond dentelé de fines stalactites et aux vitres blanchies par le givre. C'est un immense dortoir où flotte une fumée âcre. Le sol est encombré de valises ouvertes, de boîtes de conserve et de journaux froissés. Des lits de camp en désordre sont disposés en étoile à partir d'un poêle à charbon auprès duquel une vieille dame est assise. Elle s'est emmitouflée jusqu'aux oreilles dans un édredon frappé des initiales AP de l'Assistance publique. Dans ses mains protégées par d'inattendus gants de ski, elle tient une statuette représentant Santa Cruz, la sainte patronne des Oranais. Elle lève sur moi des yeux ourlés de longs cils noirs. Elle ne semble pas étonnée par ma présence. " Y a personne, dit-elle d'une voix faible. Vous voulez quoi ? Son visage s'illumine. Nous sourions tous les deux. Elle remet son gant et reprend à deux mains la statuette. La chaleur du poêle fait du bien. Dehors le blizzard continue de souffler. La vieille dame ne m'a toujours pas dit son nom. Moi non plus d'ailleurs. Mais elle parle, elle parle. Du quartier de la Marine où son père, venant d'Espagne dans les années 1880, s'installa avec sa mère enceinte. De sa naissance dans le lit familial, de son mariage avec un zouave mort pour la France aux Dardanelles en 1915 pendant qu'elle attendait leur bébé. De sa vie de repasseuse, de ses cousins républicains espagnols qui, fuyant le franquisme se réfugièrent chez elle après la guerre d'Espagne, de son fils enlevé par le FLN quelques jours après le cessez-le-feu et disparu à jamais, de sa belle-fille et ses petits-enfants dont elle n'a toujours pas de nouvelles depuis qu'elle a quitté Oran. " Des amis de mon pauvre garçon m'ont embarquée de force dans le bateau, explique-t-elle comme pour s'excuser. Ils disaient que je n'étais plus en sécurité dans le quartier. Plusieurs Européens avaient été égorgés dans leur appartement. Ils sont venus me chercher. Je n'ai pas eu le temps de faire ma valise. J'ai pris la cabassette(2) et j'ai mis quelques affaires, des vêtements, ma carte d'identité, les photos de mes morts et Santa Cruz. Elle fait le signe de croix et pose ses lèvres sur la statue de plâtre. La vieille dame pleure. Anéantie. Je baisse les yeux, respectant son chagrin. Je ne sais pas trop quoi faire, pas trop quoi dire. À quoi bon lui expliquer qu'elle a été victime de ceux qu'on a appelés " les Marsiens ", ces Algériens qui ne s'étaient pas engagés pour l'indépendance et qui, après les accords de mars, se sont déchaînés contre les pieds-noirs et les harkis. " J'ai eu très peur, très peur. Mais la tristesse m'a fait plus de mal encore ! Après... Après, on m'a mise dans le bateau. Tout en bas, dans la cale. J'ai même pas pu voir Oran une dernière fois. C'est souvent vrai. La détresse de ces naufragés de l'Histoire n'a pas provoqué un élan de solidarité nationale. En juillet 1962, au plus fort de l'exode, un sondage de l'IFOP le laissait déjà pressentir : soixante et un pour cent des Français de métropole refusaient toute idée de sacrifice à l'égard des Français d'Algérie. Treize pour cent, seulement, considéraient que la tragédie algérienne constituait encore une vraie préoccupation. Les autres avaient tourné la page. En 1955, Albert Camus avait déjà dénoncé cette stupide légende : C'est en Algérie française, qu'il compare aujourd'hui à un semis de " fascisme ", que Louis Joxe, révoqué par Vichy, avait trouvé refuge comme enseignant à l'automne 1940. À Alger, devenue en 1943 capitale de la France libre, conséquence heureuse du débarquement américain du 8 novembre 1942, que Joxe avait exercé, dans les bâtiments du lycée Fromentin, les fonctions de secrétaire général du Comité français de la libération nationale, puis du gouvernement provisoire de la République. Louis Joxe était l'un des négociateurs et signataires des accords d'Évian du 18 mars 1962 censés " protéger la garantie, les droits et la dignité des Français d'Algérie(5) ". Le général ne s'attendait pas à un départ massif des Français d'Algérie. " Une centaine de milliers seulement, disait-il. Les colons avec leurs familles qui profitaient du régime colonial1. " Il était convaincu que le reste de la population européenne s'adapterait à l'indépendance et continuerait à vivre sur le territoire : " L'Algérie nouvelle aura besoin d'eux et ils auront besoin d'elle(9). " Ces vérifications qui ne servaient à rien, sinon à amplifier une monstrueuse pagaille, retardaient les départs. Le but du gouvernement était atteint. Les arrivées en France se fluidifiaient. Mais il y avait de plus en plus de familles en détresse sur les quais d'Alger, d'Oran et de Bône. Et toujours le même déchirant spectacle de vieillards en larmes et d'enfants apeurés. Sans attendre l'autorisation de l'État, les compagnies maritimes décidèrent, dans un élan humanitaire, de reprendre et d'intensifier les allers sans retour. L'Algérie se vidait de sa population européenne, cette mosaïque composée de Français de souche et de Français par choix qu'on appelait les " néos ". Certains étaient arrivés par la force, éloignés par les régimes politiques successifs. Depuis 1830, ces émigrés avaient progressivement peuplé l'Algérie où vivaient déjà près de trois millions d'habitants arabo-berbères de religion musulmane et trente mille israélites(12). C'étaient, dans leur grande majorité, des êtres simples qui avaient apporté leur contribution à la mise en valeur de ce pays. Des petites gens et non des " petits Blancs ", ce terme péjoratif visant à faire croire qu'ils profitaient de leur statut pour dominer et exploiter la population locale. L'Algérie, c'était la France. On n'avait jamais cessé de le répéter à ces centaines de milliers d'Européens...
http://gallica.bnf.fr/VisuSNE?id=oai_demarque_17235&r=fran%C3%A7ais-d-Alg%C3%A9rie&lang=FRl
1. L'Été 62 - chanson de l'auteur. |
Mis en ligne le 24 décembre 2012