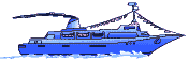 Retour au menu "Sakiet"
Retour au menu "Sakiet"
|
1958. Qu'apportera cette quatrième année de guerre ? Nul ne peut en présager. L'horizon est sans issue immédiate. Chaque camp s'enfonce dans une routine meurtrière. La voie diplomatique n'a rien donné et ne peut rien donner : indépendance, côté F.L.N., souveraineté française, côté Paris. Les contacts des émissaires socialistes avec des Algériens sont restés sans lendemain. L'impasse est totale. Aussi, plus que jamais, la parole est aux armes, mais pour s'imposer définitivement sur le terrain beaucoup de sang doit encore couler. Ainsi s'ouvre 1958, alors que le canon tonne une fois de plus dans le Constantinois. La bataille de la frontière tunisienne débute.
Pour comprendre la partie qui va s'engager il convient de regarder une carte. Le barrage électrifié couvre la frontière tunisienne mais ne la jouxte pas. Pour des raisons de commodité matérielle, dans ce terrain difficile des monts de la Medjerda où les axes routiers sont peu nombreux et la végétation particulièrement drue, il s'en éloigne sensiblement. Depuis Mondovi, le pays natal d'Albert Camus, dans la plaine de Bône, il suit la voie ferrée jusqu'à Souk-Ahras. Après quoi, dans un paysage plus dégagé, il peut piquer plein sud sur Tébessa.
C'est là, entre Mondovi et Souk-Ahras et même, plus exactement, entre Duvivier et Souk-Ahras, qu'il existe un créneau privilégié pour tenter de passer. Le barrage est alors face au " bec de canard ", le fameux saillant de Ghardimaou, qui pointe face au petit village de Lamy. L'A.L.N. a, dans ce saillant, une bonne partie de ses bases et de ses camps. De là, les katibas peuvent s'infiltrer sans grand dommage dans le massif forestier de l'oued Soudan. C'est une base de départ idéale pour s'approcher de l'obstacle, l'étudier, le franchir et s'enfoncer en Algérie. Or de l'autre côté du barrage, justement entre Duvivier et Souk-Ahras, où il va falloir faire très vite pour s'éclipser et échapper aux recherches françaises une fois l'alerte donnée, le terrain est tout aussi couvert. Sur une bande d'une trentaine de kilomètres de largeur du nord au sud, les bruyères, les lentisques dépassent souvent la taille d'un homme 1. Plus au sud s'amorcent les hauts plateaux dénudés, plus au nord s'ouvre la plaine de Bône avec ses orangeraies et le lac Fetzara, aux abords désolés et uniformes. La zone Est Constantinois est maintenant aux mains de Vanuxem. Celui-ci, de son P.C. de Bône, a vite compris quelle partie allait se jouer - le ravitaillement en hommes et munitions de la rébellion et quel prix allait y mettre le F.L.N. Il a demandé à Salan des renforts et les a obtenus. Les paras, la légion sont là 2.
Son pragmatisme ne s'embarrasse pas de formalités. Il veut de l'efficacité. Pas de guerre d'états-majors ! Une guerre de soldats, de chefs compétents. Sautant les hiérarchies et les lourdeurs territoriales, il lance ses colonels de choc : Buchoud et Jeanpierre, deux hommes qu'il sait pouvoir coller au terrain et jongler avec les moyens. A ces jeunes colonels il confie un commandement tactique bien supérieur à leur grade : troupes à pied, blindés, hélicoptères, aviation, etc. Il ne sera pas déçu.
Buchoud est à Laverdure, petit village de colonisation à une quinzaine de kilomètres au nord-ouest de Souk-Ahras. Collé au barrage, il s'axe plutôt sur les abords de la ville de Saint-Augustin. Son régiment, qu'il a créé et façonné, est constitué pour l'essentiel d'appelés du contingent, volontaires pour les troupes aéroportées. Son encadrement, qu'il a lui-même sélectionné, comporte plus d'un ancien d'Indochine. Avec Buchoud, des unités de secteur 3.
Jeanpierre domine son sujet. Il a la carrure pour, mais il est bien servi. Son adjoint s'appelle Morin 4. Ses capitaines Martin, Glasser, Besineau. Ses adjudants Tasnady, Filatof, Dallacosta. Avec lui aussi le commando d'Extrême-Orient 5 et un excellent groupe nomade de Guelma, unité musulmane normalement montée pour intervenir dans les djebels plus découverts du sud de la ville.
A Paris, à Alger, le gouvernement, le ministre résident ont suivi évidemment l'évolution militaire des combats du Constantinois mais ils sont beaucoup plus sensibles à l'écho politique et international d'un nom qui claque " Sakiet ".
" Sakiet ", c'est Sakiet-Sidi-Youssef, modeste village tunisien à l'est de Souk-Ahras et à quelques jets de pierres de la frontière. L'A.L.N. y est installée comme chez elle, occupant la majeure partie de la bourgade ainsi qu'une mine désaffectée située quelques kilomètres plus au sud. Face à Sakiet, les troupes françaises, les avions de reconnaissance, sont souvent pris à partie par des tirs algériens venus de Tunisie.
Le 11 janvier, deux sections du 23e R.I., sous les ordres du capitaine Allard, partent se mettre en embuscade à environ 700 mètres de la frontière sur un lieu de passage habituel des éléments de l'A.L.N. s'infiltrant en Algérie. Elles se heurtent à un adversaire nombreux et sont prises sous un feu nourri venu des hauteurs aussi bien algériennes que tunisiennes. Bousculées, elles ne se dégagent que grâce à l'arrivée de renforts mais perdent quatre prisonniers et ont quatorze tués, retrouvés affreusement mutilés. Le 7 février au matin, un Marcel-Dassault de reconnaissance est touché, toujours aux approches de Sakiet. Il se pose en catastrophe à Tébessa. La riposte prévue tombe. A la mi-journée, Mistral, B 26 et Corsaire piquent sur Sakiet et sur la mine, là où les cantonnements algériens ont été localisés. Quelques jours plus tard, un communiqué officiel français annoncera 130 rebelles tués.
Les projets de Chaban-Delmas, quant aux généraux en place à Alger, tournent court avec la chute du gouvernement Gaillard, le 20 avril. Une fois de plus, la France se retrouve en crise ministérielle et le président Coty renoue avec le chassé-croisé des consultations. Georges Bidault, René Pleven, renoncent ou échouent. L'Alsacien Pflimlin parait devoir l'emporter mais il ne dissimule pas ses intentions de ramener la paix en Algérie par la négociation en utilisant, le cas échéant, les bons offices de la Tunisie ou du Maroc. L'opinion européenne, les états-majors dans les départements algériens acceptent mal cette perspective d'interférence, dans le sens que l'on devine, de pays qui soutiennent longuement, ouvertement, la rébellion. Une fois de plus les éditoriaux s'enflamment, largement commentés et approuvés.
Ce premier acheminement d'un pétrole français sera suivi de bien d'autres. Les rotations s'échelonneront régulièrement jusqu'à la mise en service des grands oléoducs vers Bougie ou Edjelé en Tunisie. Curieusement, les incidents seront rares. L'A.L.N. manque de techniciens et de moyens pour saboter sérieusement l'itinéraire des trains pétroliers ou des conduites souterraines.
Tous ceux qui, le 8 février 1958, sur les quais du port de Philippeville, regardent s'éloigner ce premier navire porteur de pétrole extrait par les Français d'une terre regardée comme française, se sentent emplis de fierté et d'espérance. |
Mis en ligne le 30 juillet 2017