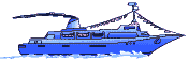 Retour au menu "Sakiet"
Retour au menu "Sakiet"
|
I. LE CONTEXTE : LA GUERRE À LA FRONTIÈRE C'est une aide politique : les chefs du FLN sont installés à Tunis, où avec Ouamrane, ils animent un " centre " qui gère les arrivées d'armes de Libye, débarquées dans les ports tunisiens. La radio d'État diffuse une émission de propagande : " La voix de l'Algérie arabe ". Enfin le sort de quelques milliers de " réfugiés " est largement exploité. Cette action était devenue libre avec le transfert de la sécurité des autorités françaises aux autorités tunisiennes, et l'évacuation par les troupes françaises de la zone frontalière. Dès novembre 1957, avaient été repérés des camps d'entraînement des futurs " fellaghas " algériens et la mise en place d'une organisation.
Les services français s'inquiétaient surtout des fournitures d'armes. Elles étaient apportées en Algérie au travers de la frontière, et, en principe, ventilées dans les wilayas. En mars 1956, avait été connue une livraison de 2 000 armes, prises aux rebelles yousséfistes, des opposants à Bourguiba, armes prises d'ailleurs par des unités françaises dans quelques combats livrés du côté de Mareth, dans l'extrême sud tunisien. Les organisateurs du FLN avaient amélioré le système de transport, obtenant d'utiliser des voitures de la Garde nationale tunisienne pour les amener au plus près de la frontière. Entre août et septembre 1957, on estima que 16 500 armes étaient arrivées de Libye et d'Égypte. Leur passage en Algérie fut freiné par la présence des unités françaises, jusqu'en juillet 1957. Leur départ, sur l'ordre de Paris, facilita la constitution de véritables compagnies de transport d'armes : des hommes, entraînés, passaient en portant trois ou quatre armes chacun, par des itinéraires repérés. Ils revenaient ensuite en Tunisie.
Le recoupement des informations permit de calculer que, entre novembre 1957 et le 15 février 1958, 15 000 armes étaient passées, dont 10 000 du 1er janvier au 15 février 1958. La complicité du gouvernement tunisien aurait ainsi permis l'armement de 34 000 rebelles, soit, comme l'écrivit l'auteur d'un rapport, " trois divisions classiques ". D'autres renseignements recoupés annonçaient la livraison prochaine de 50 000 armes dont 10 000 fusils mitrailleurs, stockés en Égypte et en Syrie [2]
Des bandes armées stationnent près de la frontière. Jusqu'en juillet 1957, ce ne sont que de petits groupes, installés dans les mechtas et perdus dans la population. Leurs bases, d'importance limitée, sont fournies par les casernes de la Garde nationale. Au mieux, ils devaient être 2 000 Algériens ainsi camouflés. Après juillet 1957, tout change. Les futurs combattants viennent nombreux vers les bases de transport et les centres d'instruction. Ce sont des unités encadrées, équipées, qui partent vers l'Algérie. Entre novembre 1957 et février 1958, au moins 10 000 hommes auraient ainsi été réunis. La construction du barrage provoque une réaction de l'adversaire. Des bandes frontalières reçoivent une mission spécifique : harceler les unités françaises à partir des bases en Tunisie. La menace risquait de devenir sérieuse avec l'afflux prévu de 50 000 armes.
La tension devient vive lorsque jusqu'à 49 est constaté que les autorités tunisiennes aident ouvertement les Algériens, en août 1957. Le 9 août, la DCA tunisienne ouvre le feu sur un avion français circulant le long de la frontière mais dans l'espace aérien algérien. Ces tirs contre les avions se multiplient : en six mois 51 appareils sont visés, 16 sont touchés. Les protestations françaises n'ont aucun effet. En octobre 1957, le général Salan, commandant interarmées en Algérie, préside un " comité de commandement " où on tente de peser le risque de ces actions locales de harcèlement et de l'aide logistique de la Tunisie et où on définit un " questionnaire " sur les moyens du FLN, à envoyer à tous les commandements concernés dans l'est constantinois [3]. "
2 / La stratégie du barrage
Le général Salan n'a cessé de donner la priorité à la frontière tunisienne. Le corps d'armée de Constantine avait reçu une " mission d'interception des convois d'armes ", en même temps qu'était commencée la construction du barrage. C'était une " mission de surveillance et d'anéantissement des bandes ", toute " action généralisée " en Tunisie étant interdite. En juillet 1957, il avait donné à cette mission une " priorité absolue "?[4]. En décembre 1957, le ministre de l'Algérie, Lacoste, avait signifié que " l'objectif principal de sa politique " était " le barrage à la frontière et l'anéantissement des bandes rebelles ", précisant : " Je place maintenant en première urgence le plein-emploi du barrage, l'interception des convois et la destruction du personnel tant de transport que d'escorte " ; on y concentrerait " le maximum de moyens ". Mais il limitait ces actions à des " interceptions " en Algérie ou dans " la zone avoisinant le barrage " [5].
Son état-major envisage même l'hypothèse d'un " franchissement important " que semblent annoncer les énormes moyens accumulés dans les bases de la frontière. Cette offensive adverse se situerait entre la frontière et une transversale Philippeville-Constantine-Batna. Une bataille ample est étudiée : défendre la Dorsale montagneuse, attaquer " au moment de la concentration rebelle sur le barrage " avec des unités parachutistes héliportées, prévoir une deuxième zone d'interception sur la transversale définie. Il ordonne donc " d'intercepter, d'attaquer et de détruire un convoi au plus près de la frontière ", avec " l'ensemble des moyens de la zone Est constantinois ". Il conçoit donc le barrage, à cette date, comme " une ligne d'arrêt " pour " mettre hors de combat " les éléments adverses?[7]. Il s'agit du premier barrage, dit " ligne Morice " établi à partir de juin 1957. Il avait été tracé le long de la route ou de la voie ferrée Bône-Souk Ahras-Tébessa. Il traversait au plus court, des défrichements rapides en avaient dégagé la place. Mais de vastes surfaces, couvertes de végétation, avaient été préservées entre le barrage et la frontière. Les convois ennemis s'y faufilaient s'en être repérés [8].
À la fin de janvier 1958, Salan constate que l'interception est " inefficace " malgré des résultats remarquables mais " insuffisants ". Les convois ne sont " pas en mesure de traverser le barrage " s'ils ont à soutenir un combat. Ils ne le font qu'à coup sûr, " là où ils disposent de réseaux " encore inconnus [9]. Il y a concentré de gros moyens : 3 bataillons de tirailleurs, une division de réserve générale, une autre, la 11e DI, repliée de Tunisie, bref il est en train d' " hypothéquer " des moyens nécessaires ailleurs, pour peu d'effet.
3 / Les incidents de frontière et leurs risques
Pendant l'été 1957, les services français enregistrent de nombreux incidents voulus par les Tunisiens. Au début on estima que la responsabilité en incombait au FLN, qui aurait préparé une attaque de la frontière à partir du 15 septembre. Le 30 août, fut signalée une proche " attaque du Kouif à partir d'une base de départ située en Tunisie ", au point que Salan demanda au gouvernement l'autorisation de " faire procéder à certaines actions particulières "visant" la destruction de bandes FLN en territoire tunisien frontalier ". Il lui offrait même de lui fournir des " preuves de la collusion " à partir de la " capture de rebelles armés et de dépôt d'armes " [10].
À Paris, le ministre Chaban-Delmas craignait qu'un incident ne servît de déclencheur à une crise franco-tunisienne. Dès juillet 1957, il avait exigé d'avoir " dans les plus brefs délais " les renseignements " sur les incidents frontaliers ", pour les transmettre aux Affaires étrangères [11]. Salan répercuta l'ordre, " éviter de la façon la plus absolue tout acte ou intervention les amenant à pénétrer en territoire étranger ", sauf pour terminer un combat commencé en Algérie. Cela devait être " parfaitement établi ".
Les incidents se multiplièrent, quelques mitrailleuses tirant, depuis le sol tunisien, sur tout avion patrouillant le long de la frontière mais au-dessus de l'Algérie : 15 tirs du 18 au 30 septembre 1957, dont 8 avec impact?[12]. Ce harcèlement, sans grand effet à court terme, était mal vécu par les militaires français, ce qui était peut-être le but recherché. En voici deux exemples significatifs :
Au début d'octobre 1957, deux avions T6, en patrouille sur le Djebel Gouboul, à 45 km au sud-est de Tébessa, découvrent " une caravane de douze mulets portant des caisses et convoyée par trois hommes qui ont ouvert le feu ". Leur riposte tue " douze mulets et un convoyeur ". Comme ils volaient au-dessus du sol tunisien, on invoqua le mauvais temps et une erreur. Salan ne put que rappeler son interdiction de pénétrer en territoire tunisien [13]
Le 30 janvier 1958, un avion couvrant un convoi entre Souk Ahras et Bordj M'Raou est " pris à partie par des armes automatiques du poste de Oued Zitoun occupé par l'armée tunisienne " bien qu'il volât en Algérie. Il est touché et s'écrase en Algérie à 3 km de Souk Ahras.
Cela autorise Salan à tourner l'interdiction du ministre, " en cas de tirs à partir du territoire tunisien, la riposte sera systématique dans les trois heures suivantes " [14.] Son adjoint, le général d'aviation Jouhaud, précise dans une note que les mitraillages et les bombardements ne peuvent être autorisés que par le commandement terrestre, mais que les " ripostes aux tirs de la DCA adverse " en sont dispensées. Il couvre donc une " attaque immédiate par avion, à partir ", une " demande de tir adressée par l'armée de terre ". Il maintient les opérations de reconnaissance et de survol des bases tunisiennes, avec prise de photographies mais " sans pénétrer en Tunisie " [15].
C'était utiliser habilement " le droit de suite " que le ministre Chaban-Delmas avait laissé reconnaître. Salan utilisait un argument clair : empêcher tout appui militaire externe en détruisant le potentiel militaire ennemi, puisque ce but ne peut être atteint en Algérie [16]. Le 9 août, le ministre avait autorisé son exercice sur " une profondeur de 25 km conformément au droit international " [17]. Quelques jours plus tard, il avait confirmé ainsi : " Vous donne accord extension à Tunisie droit de suite profondeur 25 km ", interdisant les " opérations montées a priori " [18]. Dès le lendemain Salan transmettait à Constantine l'accord ministériel, donné, disait-il, " à ma demande ". Il prévenait de se méfier d'un guet-apens amenant " unités françaises faibles devant unités rebelles en force " à se trouver " devant une situation combat avec armée tunisienne " [19]. Fin août le ministre y revenait :
Lacoste, à son tour, au milieu d'octobre 1957, conseillait une grande prudence devant la Tunisie, dont le gouvernement ne reculerait devant rien pour " se mettre en valeur sur la scène internationale ". Il faut " que nous apparaissions de façon incontestable en situation défensive et non agressive ". Les avions devraient éviter " d'intervenir au sol sur les éléments stationnés en Tunisie et en Libye ", ce qui serait présenté " comme un acte délibéré d'hostilité " [22].
II. LE DRAME MÉDIATISÉ : UNE EMBUSCADE, UN BOMBARDEMENT
1 / L'embuscade du 11 janvier 1958
La version française est simple : ce jour-là, une compagnie du 23e RI, forte de 50 hommes, est attirée dans une embuscade. Son chef, le capitaine Allard, avait été trompé par son informateur, qui l'avait incité à monter une embuscade sur un itinéraire utilisé pour pénétrer en Algérie. L'enquête confirma que l'embuscade avait eu lieu en territoire algérien [23]. : une patrouille est partie à 2 km au nord-est d'un Djébel.
" Ses éclaireurs de pointe détectaient deux rebelles en tenue militaire et en armes, qui paraissaient faire le guet. Le capitaine Allard donnait l'ordre de les prendre en chasse et, en compagnie de cinq fantassins et de gendarmes, il se lançait à leur poursuite. Les hors-la-loi s'enfuyaient aussitôt vers le Djébel et entraînaient les poursuivants sous le feu d'une embuscade tendue par l'adversaire au pied même du massif montagneux. "
Deux jours plus tard, le gouvernement tunisien fit diffuser une dépêche déclinant toute responsabilité, le combat " s'étant déroulé entièrement en territoire algérien ". Le rapport du gouverneur de Kef, décrypté par les services français, révéla comment le gouvernement tunisien était informé [25] :
À l'état-major d'Alger on interpréta différemment les faits : la complicité tunisienne est évidente, des camions avaient amené les Algériens sur les lieux. Vers 6 heures, furent aperçus " deux camions venant du village de Sakiet ", " qui circulaient tous phares allumés sur une route longeant la frontière du côté tunisien ", un troisième camion " un peu avant la fin des combats ", deux 6 GMC bâchés, une Jeep et une 2 CV Citroën arrivaient de Tunisie. Le convoi s'était arrêté " non loin de la frontière " ; y montèrent les " rebelles " qui " repassaient la frontière ", pour embarquer dans les véhicules et regagner Sakiet.
Une camionnette bleue de la Garde nationale, " trois camions militaires " stationnaient aussi. Vers 16 heures, deux avions aperçurent " 6 camions et camionnettes " et de nombreux " militaires armés " qui leur tirèrent dessus. Le capitaine Allard avait été frappé de l'attitude ambiguë des Tunisiens : " Au plus fort de l'action, une section de gardes nationaux tunisiens, reconnaissables à leur casquette plate, arrivés en camion, prenaient position le long de la frontière. Il est intéressant de noter que cette unité ne prenait aucune mesure pour faire cesser les tirs de mitrailleuses et de mortiers installés près d'elle en territoire tunisien. "
Quant au général Salan, il y vit la confirmation de cette " cobelligérance " qu'il ne cessait de signaler. Étaient évidentes les complicités des " autorités locales " qui n'avaient pu ignorer " la préparation d'une action aussi importante " et de la " Garde nationale " de Sakiet [26].
Le droit de suite ne fut pas exercé à cause des trop longs délais pour réunir les forces nécessaires : à 16 heures, il eut été trop tard et, comme on n'avait " aucune certitude de présence rebelle sur le territoire tunisien à proximité du lieu de l'embuscade ", les Tunisiens auraient parlé " d'une attaque ". L'aviation, arrivée à 11 h 10, aurait pu " infliger des pertes sérieuses " aux " rebelles encore proches de la frontière ". Mais cela dépendait d'un ordre du commandement terrestre, qui ne fut pas donné. Salan et Lacoste n'eurent d'autre voie que de presser le gouvernement " d'élever une vigoureuse protestation à Tunis " [27].
Enfin le Commandement français découvrit les méthodes de guerre du FLN. L'adversaire avait engagé au moins 300 hommes, leur tir avait été " parfaitement ajusté ", les combattants étaient " entraînés et parfaitement encadrés ". Leur chef était Nobel Zine, de la 9e compagnie du 4e bataillon de la wilaya de Souk Ahras [28].
Les cadavres français portaient la marque d'une certaine cruauté. On avait achevé 12 des 14 tués " par des instruments tranchants, piquants et contendants ou par balles ". Trois portaient un tatouage autour de " l'orifice entrée projectile ", démontrant qu'il y avait eu coup de grâce et que douze corps avaient été mutilés, " on note deux tentatives d'amputation, un égorgement, une carbonisation. Pour tous, défiguration. Acharnement dans mutilation des victimes est démontré par état des corps et multiplication impacts ". Un rapport de gendarmerie précise : " Les rebelles s'étaient livrés à l'encontre des militaires mis hors de combat à un certain nombre d'atrocités : cadavres piégés, cadavres arrosés d'essence et partiellement incendiés, blessés achevés d'une balle à bout portant, morts dévalisés. " [29].
Le Commandement français comprit aussi, par une écoute téléphonique, le sort des prisonniers. L'aspirant Godet, transporté blessé au Kef, y était mort ; il avait été ramené sur le terrain. Les autres prisonniers eurent la vie sauve grâce à deux chefs du FLN, Mohamed Lakdar, du PC du Kef, et Mohamed Harfic, du PC de Tunis. Le premier fit conduire très vite trois prisonniers à Tunis. Peu après midi, Mahmoudi téléphona à Lamouri, chef de bataillon de Tadjerouine, " donne des instructions pour qu'on n'exécute pas ces mécréants ". Ordre répété ainsi : " Attention, qu'on ne les tue pas. " Le 13 janvier, Chefir Mahmoudi expliqua cette clémence : " Ces salopards, que vous détenez, nous seront d'une grande utilité et surveille que rien ne leur arrive... Et qu'on ne les maltraite pas, nous ne pourrions nous en servir. "[30].
Dès le 12 janvier, Bourguiba avait imposé aux Algériens de masquer la complicité tunisienne et de profiter de la visite de délégués de la Croix- Rouge : ramener les prisonniers en Algérie, pour prouver que l'armée du FLN respectait la Convention de Genève [31]. Salan précisa : " Cette visite ne comporte aucune négociation de notre part avec éléments FLN. " [32].
2 / Le bombardement de Sakiet (8 février 1958)
Un nouvel incident au-dessus de Sakiet fut le prétexte d'une réponse française violente. La chronologie en est connue :
7 février 1958 :
Cette affaire doit être replacée dans son contexte militaire. Après l'embuscade de janvier, Salan avait décidé de répliquer. Le 15 janvier, il avait convoqué les généraux Loth et Vanuxem, qui commandaient l'Est constantinois, pour qu'ils préparent " des ripostes locales " à déclencher sur ordre du général Ely, à Paris. Il avait ramené de Tougourt le 1er REI et mis l'embargo sur le 3e RPC. Il avait imposé un strict secret, n'informant ni la 10e DP ni le corps d'armée d'Alger. Le général Ely ne l'en dissuada pas, lui envoyant même un de ses officiers " susceptible de donner éléments pour une décision qui pourrait être prise à Paris " [33]. Il mit en alerte un régiment de parachutistes de la " Force d'intervention ".
Le général Ely acceptait une opération contre les bases du FLN dans le nord de la Tunisie. En janvier 1958, quelques jours après l'embuscade, il en renouvelait l'autorisation à Salan [34].
Quatre jours plus tard, Salan télégraphie au général Loth, dont dépendaient les opérations sur la frontière [35] : " Je vous donne tous pouvoirs de déclencher à votre initiative toute opération coup de poing sur les bases FLN à l'est de la frontière tunisienne... et de saisir toute occasion favorable d'infliger aux rebelles une leçon sanglante. "
Sakiet a été la cible, pour des raisons stratégiques. Ce village était à une centaine de mètres de la frontière. Il était devenu une base de transit et de départ de convois vers les wilayas 2 et 3. Il était aussi la base du 3e bataillon de la wilaya de Souk Ahras, spécialiste des attaques entre la frontière et le barrage : il avait attaqué le poste d'Agroub Kerma le 20 octobre 1957 et, on l'a vu, il avait monté l'embuscade du 11 janvier 1958. Sakiet était devenu un village algérien, le délégué tunisien en avait expulsé les habitants français. Les défenses avaient été construites selon les plans du FLN : divers locaux, dont la maison forestière, étaient occupés, où des Fellaghas cohabitaient avec la Garde nationale. Dans le village, trois emplacements de la DCA couvraient ce dispositif : deux à l'intérieur de la place centrale, un autre sur le poste de douane. Surtout un camp algérien, protégé par six emplacements de la DCA, se trouvait à l'ancienne mine, à 6 km du village. Ce camp utilisait les bâtiments comme dortoirs, l'école désaffectée comme PC. Il avait servi au tournage d'un documentaire anglais sur l'entraînement des combattants algériens [37]. Un prisonnier révéla, ultérieurement, que les bâtiments pouvaient contenir 500 à 600 hommes et qu'au moment du bombardement, 600 hommes s'y trouvaient. Mais la défense anti-aérienne était assurée par des soldats tunisiens et par des gardes nationaux [38].
Salan avait ordonné de tenir compte de cette imbrication de civils et de " rebelles ". Aussi les armes automatiques lourdes du village même furent attaquées en piqué, par des " Corsair ", avec des bombes de 500 lbs, afin d'épargner la population. Au contraire la mine fut " traitée " par des bombardiers larguant des bombes plus lourdes munies de fusées retard afin de détruire les abris des armes automatiques. Quant au plan d'objectifs, il était prêt depuis les premiers incidents. Salan, dans ses rapports insista sur la précision des tirs.
Cette opération est à replacer dans l'ensemble des actions conduites dans cette région frontalière : 163 actions ayant mobilisé 220 bataillons. Deux convois d'armes avaient été détruits ainsi que dix bandes locales. Tout avait été d'une " violence et d'une dureté telles que nos pertes ont été plus élevées que de coutume ". Le bombardement provoqua, par précaution " la dispersion provisoire des "camps ennemis" et l'éloignement de la frontière de leur logistique à l'intérieur de la Tunisie. " [40] III. LA CRISE
Le désaveu gouvernemental ne traîna pas. 1 / Tout était changé par le jeu de Bourguiba
Bourguiba a tout de suite dramatisé sa réaction. Interrompant son week-end à Monastir, il revint " en trombe à Tunis pour y présider un Conseil des ministres extraordinaire réuni d'urgence ". Puis il intervint à la radio, " d'une voix tragiquement contenue " pour annoncer diverses mesures dont la demande d'évacuation des troupes françaises, de restitution de Bizerte, doublées du rappel de l'ambassadeur à Paris et d'une plainte à l'ONU [45]. Il a, aussi, autorisé une mise en scène à Sakiet. La propagande officielle explique que les projectiles français n'avaient touché que les Tunisiens, surtout des femmes et des enfants. Les journalistes étrangers furent empêchés de visiter les galeries de la mine de Sakiet. On leur présenta les corps des tués comme de paisibles citoyens, alors que c'était ceux de fellaghas algériens. La désinformation poussa à présenter l'école de la mine, désaffectée depuis longtemps, comme atteinte alors que des enfants s'y trouvaient en classe.
Ce bombardement fut effectué un jour de marché et un jour où des délégués de la Croix-Rouge internationale étaient venus distribuer des vêtements à des adolescents, en principe enfants de réfugiés algériens. Le temps qu'ils soient rassemblés dans le village, le délégué avait emmené les délégués à quelque distance, d'où ils purent voir les avions opérer mais où ils ne risquaient rien. Un camion a été touché, car sa croix sur le toit était peu visible, effacée par le temps.
Un diplomate neutre sur place a expliqué cette curieuse attitude par la nécessité pour Bourguiba de sauver son autorité. Depuis des mois, il essayait d'amorcer une politique de rapprochement avec la France contre des concessions économiques et financières qui ne venaient pas. Ces pourparlers sur une alliance avec la France " avaient suscité, surtout dans les milieux destouriens, une véritable opposition ". Le ministre de l'Intérieur, Mehiri, poussait à un rapprochement avec Nasser. Enfin, le gouvernement américain avait débloqué difficilement les crédits de son assistance technique, alors qu'il aidait la France, indirectement, dans la guerre d'Algérie [46].
2 / Le blocus des garnisons
Bourguiba a laissé reprendre un blocus des garnisons selon la technique amorcée en 1956. Il compte affamer les troupes en interdisant de les ravitailler. Dès le 12 février, le général Gambiez, commandant supérieur, alertait le gouvernement : il fallait nourrir 45 000 hommes dont 26 000 à Tunis sans compter les familles [47]. Le lendemain, il signalait que le goulet de Bizerte étant fermé par les Tunisiens, on devrait prévoir d'amener le ravitaillement par avion à Sidi Ahmed, l'aérodrome de Bizerte [48]. Il annonçait aussi que l'état-major français était isolé à Salammbô, dans la banlieue de Tunis, par la police et l'armée tunisiennes, et qu'il ne pouvait plus communiquer avec l'ambassadeur de France, sauf par le conseiller militaire [49].
Le 13 février, Ely ordonna de livrer le ravitaillement par des hélicoptères se posant à Bizerte?[50], en réduisant " au minimum les risques d'incidents " [51]. Le ministère montra la prudence du serpent. Huit hélicoptères furent chargés sur le porte-avions Bois Belleau, ils quittèrent Toulon le 16 février pour Bône, d'où ils rejoindraient Bizerte [54]. Le ravitaillement alimentaire n'était pas le seul problème. Très vite, l'armée en Tunisie manqua de tout : à Gabès, le service du matériel était dépourvu d'acétylène et d'oxygène, à Tunis le génie ne recevait plus de matériaux de ses fournisseurs locaux, partout les liaisons radio étaient réduites pour ne pas épuiser les batteries des postes. Enfin, le carburant, malgré une faible consommation, manquait, les besoins étant de 80 m2 au moins [57].
3 / L'intervention des États-Unis
Cette intervention, par l'offre des " Bons offices ", est une conséquence inattendue de l'affaire de Sakiet. Un témoin, le général Gambiez, fit rédiger une analyse de cette affaire [58] : " Il (Bourguiba) a décidé le 8 de créer à son profit une nouvelle affaire de Suez, en acculant l'Armée française à une action de force par l'interdiction qu'il lui faisait de se déplacer et de se ravitailler. Il espérait, par contrecoup, internationaliser le problème algérien. En même temps, il a cherché à soulever son peuple et l'opinion internationale dont le soutien lui était nécessaire. Il a réussi sa manœuvre jusqu'au 15 février, date à laquelle les pressions internationales et le manque d'enthousiasme de la population tunisienne l'ont obligé à changer de tactique. Par des provocations successives, il a essayé alors d'atteindre le même but avant l'arrivée des diplomates chargés des bons offices... Avec l'arrivée de M. Murphy, commence une nouvelle phase dont les rapports avec le bombardement de Sakiet sont lointains... "
Le secrétaire d'État, Dulles, cherchait depuis des mois à s'imposer dans l'affaire algérienne où il voyait une cause d'affaiblissement de la face méridionale de l'OTAN. Le bombardement du 8 février allait donner à Dulles l'instrument qu'il cherchait. Dans une conférence de presse, Dulles prit le risque d'une crise avec la France. On ne sait qui lança l'idée d'une mission de bons offices. Une rumeur l'attribua à Tunis. Pineau, le ministre, avait demandé au gouvernement américain d'intervenir pour débloquer le ravitaillement des garnisons. Le Département d'État détacha un diplomate connu pour sa francophobie, Murphy. Le cas de cette crise de Sakiet permet d'esquisser quelques réflexions méthodologiques sur l'histoire de cette guerre d'Algérie.
|
Mis en ligne le 06 août 2017