|
Le parti républicain et la question coloniale ! Voici un sujet que nous
trouvons inévitablement au centre de tout travail sur la Troisième République.
La république colonisatrice, c'est d'abord celle de Jules Ferry et ce, au point de
nous donner bien trop souvent l'impression que l'idéologie sur laquelle repose
cette politique est un apport venu se greffer sur la pensée républicaine dans les
années 1880. La colonisation serait ainsi la face négative de Jules Ferry - Janus,
opposée à sa face positive, celle de l'école laïque; une sorte de trahison des
valeurs traditionnelles de la république consentie par des républicains modérés
installés durablement au pouvoir.
Nous le savons : rien n'est plus faux que cette vision des choses. « L'idéal colonisateur » est indissociable de l'histoire du parti républicain français depuis
son origine. Il n'est pas un produit de la corruption que la pratique ferait peser sur les idées mais bel et bien un des points du programme des démocrates dès la première moitié du XIXe siècle. Le parti républicain n'est
pas devenu, il est colonisateur.
De ce point de vue, il nous a semblé particulièrement intéressant d'étudier
l'attitude de la gauche républicaine au moment de la première colonisation de
l'Algérie : de la prise d'Alger le 5 juillet 1830 à la reddition d'Abd el-Kader le 23 décembre 1847.
— Tout d'abord parce que cela nous permet d'observer la conjonction de
deux phénomènes nouveaux : l'émergence, au lendemain des Trois Glorieuses, d'un parti républicain distinct des autres partis, doté de journaux, de brochures, de clubs, d'associations...; et dans le même temps l'amorce d'une politique
coloniale moderne 1.
— Ensuite, parce que la période de la monarchie de Juillet nous présente un
mouvement républicain naissant, cantonné dans un rôle d'opposition, victime
de la répression du pouvoir de Louis-Philippe. Un parti dont les dirigeants
subissaient des peines d'emprisonnement pour délit d'opinion. Un parti dont la
propagande et les journaux essayaient difficilement de survivre face à l'arsenal
législatif mis sur pied — notamment en septembre 1835 — par le gouvernement.
En un mot, le parti des « républicains de la veille » que l'on opposera
plus tard aux « républicains du lendemain ». Ceux que l'on ne peut en aucun
cas accuser d'avoir corrompu l'idéal originel de la République pour la simple et
bonne raison qu'ils en sont en bonne partie les fondateurs. Ceux qui nous
permettent sans doute le mieux de remonter aux origines de la pensée républicaine.
— Enfin parce que, à travers l'histoire du parti républicain sous la monarchie de Juillet, nous pouvons étudier les positions de tous les grands courants
de la gauche française : Républicains radicaux et démocrates tout d'abord bien
sûr, mais aussi socialistes (Louis Blanc) et même communistes (Cabet,
Laponneraye, Lahautière...) qui commencent à émerger, non pas comme partis
à part entière, mais comme composantes de la famille républicaine.
Pour effectuer le travail sur les sources, nous nous sommes concentrés sur
une étude de presse. La question algérienne n'étant tout de même pas au centre
de la propagande républicaine, il nous a semblé que toute autre méthode nous
conduirait à n'avoir qu'une vision superficielle, n'engageant pas la totalité du
parti républicain, des problèmes posés.
Comme source principale, et systématiquement dépouillée, nous avons choisi les deux grands quotidiens de la gauche républicaine durant la période :
La Tribune et La Réforme. Ils ont l'immense avantage d'être à la fois plus complets, plus près de l'actualité de l'époque, grâce à la régularité de leur parution, et en même temps d'être les meilleurs révélateurs de l'opinion des démocrates. Ils ont par contre l'inconvénient de ne pas couvrir l'ensemble de la période qui nous intéresse ; le dernier numéro de la Tribune date du 11 mai 1835 et le prospectus de la Réforme du 29 juillet 1843, laissant ainsi le parti républicain, huit années consécutives, sans organe quotidien lui permettant de
faire entendre sa voix.
A côté de ces deux grands titres, nous ferons appel principalement au Journal du Peuple de Dupoty, mais aussi à plusieurs parutions communistes comme l'Intelligence de Laponneraye, la Fraternité de Lahautière et surtout le Populaire de Cabet.
1. Cf. notamment les ouvrages de référence de Charles- André Julien : Histoire de l'Algérie contemporaine, t. 1, Paris, 1979 et de Charles-Robert Ageron : Politiques coloniales au Maghreb, Paris, 1973.
I. — LA « MISSION CIVILISATRICE DE LA FRANCE »
Si la France doit coloniser l'Algérie, c'est d'abord, pour les membres du Parti républicain, parce qu'elle a une mission civilisatrice à accomplir.
Conquérir l'Algérie, c'est participer à l'extension du progrès, aider les
« Lumières » à recouvrir l'ensemble de la planète : « Le tour de l'Afrique est venu dans l'ordre de la civilisation » 2.
La lutte entre la France et l'Algérie, c'est l'affrontement entre « la civilisation et la Barbarie » : « Nous l'avons dit il y a longtemps, l'Algérie est un
terrain d'expérimentation sociale. Il faut y importer la civilisation en progrès »,
écrit dans la Réforme du 19 octobre 1844 un rédacteur signant G. C. 3.
2 . Le Journal du Peuple, 16 mai 1841.
3 . Nous croyons pouvoir identifier sans trop de problèmes ce publiciste comme étant Godefroy
Cavaignac. Non seulement les initiales correspondent à celles de ce grand leader du Parti républicain
sous la monarchie de Juillet, ancien président de la Société des droits de l'Homme, revenu en France
depuis 1841, et actionnaire fondateur de la Réforme (aux côtés notamment d'Arago, Louis Blanc,
Caussidière, Flocon, Crémieux, Ledru-Rollin, Schœlcher...) à laquelle il collaborait régulièrement;
mais de surcroît son intérêt pour la question algérienne était bien connu. Son «jeune» frère
— d'un an son cadet — Eugène combattait alors dans l'armée d'Afrique. La Réforme ne ratera
jamais une occasion d'opposer ce dernier, l'exemple du «bon général français » au «mauvais »
Bugeaud; image d'ailleurs fortement remise en cause aujourd'hui (cf. F. MASPERO, L'honneur de
Saint-Arnaud, Paris, 1993). Quand Godefroy Cavaignac décédera, début mai 1845, Ledru-Rollin,
dans le discours qu'il prononcera lors de l'importante manifestation qui accompagnera son
rendra hommage à son frère « combattant depuis quinze ans sur la terre étrangère pour
conserver quelques honneurs à ce drapeau que d'autres oublient de faire respecter ». Nous ne trouvons
bien sûr plus d'articles signés G. C. après mai 1845
Cette idée est bien connue, venant de républicains des années 1840, elle a
pourtant besoin d'être précisée. Que la France ait une mission civilisatrice sur le
monde, cela semble naturel pour un homme de la IIIe République qui voit enfin
le régime pour lequel il combat depuis près d'un siècle s'installer durablement
en France. La France républicaine, parce qu'elle est un modèle politique et
moral, parce qu'elle est la nation des droits de l'Homme dont elle incarne les
principes, se doit de civiliser les peuples jugés comme barbares. Mais la France
monarchique de Louis-Philippe peut-elle en dire autant ? Le régime censitaire
honni, qui emprisonne les républicains et que ceux-ci n'hésitent pas à affronter
les armes à la main, peut-il jouer le même rôle ? Il y a là une contradiction, ou
tout du moins une interrogation à laquelle il fallait apporter une réponse.
Certes notre ordre social est bien gangrené encore, mais l'état de barbarie, vraiment, c'est bien
pis ! Le sort de ces populations que vous soumettez était abominable ; il faut que notre empire
leur profite, il y va de votre gloire, à la fois, et de votre intérêt 4.
Nous l'avons dit ; les sociétés barbares, c'est le fond des sociétés civilisées qui est restée à la
surface ; cet état intermédiaire entre le sauvage et l'homme policé, est le plus vicieux de tous.
Notre ordre social est encore bien mauvais pour le plus grand nombre, pour les pauvres, pour
les faibles ; mais enfin, sa force d'ascension les retire peu à peu de cette fange où a croupi le
genre humain. [. . .] Mais chez les barbares, bien plus encore que chez nous, le puissant dit : tu
es pauvre, enrichis-moi ; tu es faible, porte- moi. La condition des femmes est la dernière
expression des abus de la force et le dernier degré de cette gravitation de la tyrannie, qui
d'opprimé en opprimé, vient tomber sur le plus faible de tous 5
4. La Réforme; 17 mai 1844.
5 . La Réforme, 10 juin 1844 (article signé G. C).
Ce qui donne sa mission à la France, c'est son histoire, et la place que celle-
ci lui a donnée parmi les nations. Le nationalisme fervent des républicains
signifie d'abord la conviction que la France a, indépendamment même du
gouvernement qui la dirige, un exemple à donner aux autres peuples. Pour eux,
chaque nation, chaque peuple est doté d'un rôle qui lui est spécifique.
Certaines, essentiellement en Europe, mais aussi la jeune démocratie
appartiennent à la « civilisation », d'autres à la « barbarie ». Il est du
devoir des premiers d'aider les seconds à sortir de leur condition jugée.
Coloniser c'est donner un coup d'accélérateur à l'histoire de peuples restés
à un « stade arriéré », c'est ainsi, d'un certain point de vue, les émanciper.
Ces positions, les républicains les développent en rejetant tout racisme, tout
du moins dans le sens habituel du mot. Pour eux, les hommes sont égaux
devant la nature, les inégalités qui existent sont le produit de l'histoire. S'il y a
des « peuples barbares », cela ne peut donc en aucun cas être le fait d'une
quelconque « infériorité de certaines races humaines ».
A ce propos, disons qu'on a, par une idée fausse, conclu du dogme de la résignation et du fatalisme
que l'Arabe était impropre au progrès et que, s'il était nomade dans ses mœurs, il était
immobile dans sa condition. L'Histoire de ce peuple suffirait pour démentir cette idée. Si les
Arabes de l'Algérie n'ont pas progressé, cela tient au détestable gouvernement qui les a fait
déchoir, au climat, à une sobriété de besoins, qui stimulent peu les hommes, lorsqu'ils sont
accablés d'ailleurs par leurs conditions 6.
6. La Réforme, 4 juin 1844.
D'où la nécessité de coloniser, non pas pour opprimer, mais bien au
contraire pour « civiliser », c'est-à-dire pour permettre aux peuples du monde
de bénéficier des progrès accomplis par le seul Occident. Cette aspiration est
incontestablement le premier guide de la politique du parti républicain.
Mais pour que cette « œuvre » puisse se réaliser, pour que la France
puisse accomplir sa « tâche », il faut que certaines conditions soient remplies.
En premier lieu que les armées conquérantes, mais aussi les colons, fassent
preuve de la plus grande humanité vis-à-vis des populations des territoires
occupés. La « civilisation » ne peut être attractive que si elle est capable de se
montrer sous son meilleur jour, elle doit faire la preuve éclatante de sa supériorité
en rejetant tous les actes de barbarie qui accompagnent généralement les
guerres et les conquêtes. Elle se doit d'utiliser une véritable pédagogie du
progrès :
Le sort des indigènes, nous avons déjà eu l'occasion de le dire longuement dans La Réforme,
n'est pas seulement pour la France une question de civilisation et d'honneur, ni même une
question d'intérêt et de sûreté actuelle. L'avenir en dépend. A cette distance et si la France fait
son devoir vis-à-vis des populations conquises, loin de voir en elle des ennemis, nous y apercevrons
une base solide de notre domination et de son maintien 7
7. La Réforme, 29 octobre 1844.
C'est cette politique, pensée comme étant humaniste, qui doit assurer le
succès de la colonisation en faisant la démonstration de la supériorité de la civilisation.
Nos sociétés sont meilleures, nous devons le démontrer. Tel est le postulat simple posé par les républicains et qui, selon eux, fait la spécificité de la colonisation française :
C'est une grande occasion pour la France de prouver à l'Europe que l'esprit de conquête a fait
place chez elle à l'esprit de délivrance et d'émancipation. Lorsque nous mettons un grand prix à
ce que l'Angleterre ne s'empare pas d'Alger, est-ce seulement pour un étroit égoïsme
national ? Non; c'est que l'Angleterre exploite et ne colonise point ; elle établit des comptoirs, elle épuise un pays ou le rend tributaire, mais peu lui importe la liberté, l'extension des
idées fécondes qui doivent partout améliorer l'espèce humaine. L'Angleterre est égoïste ; la
France est sympathique. Voilà pourquoi, placées au même degré de Lumière, de force et de
puissance, ces deux pays exercent une influence si diverse 8.
8 . La Tribune, 19 juillet.
C'est bien en termes de générosité, voire de philanthropie que les républicains
conçoivent la colonisation de l'Algérie par la France. Cette dernière remplit
ainsi la mission que l'histoire lui a donnée, notamment dans la lutte contre le
mercantilisme anglais. Pour eux, conquérir c'est assurer le rayonnement d'une
civilisation et d'une culture jugée comme supérieure avant d'accroître la puissance
économique de la Nation.
Cet « humanisme », cette « générosité » dont les conquérants doivent
faire preuve vis-à-vis des populations occupées, a pourtant fait l'objet d'une
relative évolution dans la propagande républicaine. Au début — dans les années
1830-1834 — , on prône une liberté totale, certain que l'exemple du haut niveau
de civilisation importé par les colons ne pourra que séduire et permettre ainsi
une évolution de la société algérienne :
II faut qu'Alger soit une ville libre conservant provisoirement sa langue, sa religion, ses
usages, jusqu'à ce que les importations européennes les modifient, les changent par les
exemples de bien-être quelles y introduiront. Ceci est l'œuvre du temps et une œuvre infaillible 9.
9 . Idem. Il faut dire que ce texte est écrit alors que les républicains sont persuadés que le
gouvernement va renoncer à sa conquête. Cette solution est donc présentée comme un « moindre mal » permettant à la France de garder une position prédominante en Algérie.
Puis, au fur et à mesure que se développera la guerre, qu'Abd el-Kader
organisera la résistance contre les Français, les républicains se feront moins
compréhensifs et plus répressifs ; ils multiplieront, nous aurons l'occasion de
l'examiner, des prises de position allant dans le sens d'un emploi quasi systématique de la force.
Pourtant, malgré ces évolutions, le parti républicain, pendant toute cette
période, a su tenir bon sur un certain nombre de principes démocratiques, de
libertés fondamentales qu'il souhaitait voir préserver.
— En premier lieu, nous voudrions mentionner la condamnation systématique
des exactions commises par l'armée française, voire les colons, condamnation
faite au nom du principe intangible du respect de la personne humaine,
du droit imprescriptible à la vie et à la dignité. Cela est vrai en 1833 quand la
Tribune dénonce le trafic fait par certains Français sur le marbre des tombeaux
et même sur les ossements humains. Cela est vrai aussi en pleine guerre,
notamment en 1845 quand le colonel Pelissier fait périr par le feu huit cents
personnes des tribus du Dahra, de tous sexes et de tous âges, venues se réfugier
dans une grotte. La Réforme, dans son édition du 13 juillet, demande avec la
plus grande virulence le châtiment de Pelissier et sa comparution en conseil de
guerre. Lorsque, quelques mois plus tard, des prisonniers français sont
égorgés, la Réforme polémique durement avec le journal L'Époque qui justifie
alors le sang par le sang, explique le massacre du Dahra par celui de Djemmâ.
Nous voulons toujours et partout que l'intérêt national soit le guide de nos actions et de nos
paroles. Mais le premier caractère de notre nationalité française, c'est son amour sincère et
profond de l'humanité. Or l'humanité ce n'est pas la France ou l'Europe, c'est l'Afrique aussi.
La liberté est aussi bonne là qu'ailleurs ; et c'est un triste moyen de colonisation, il faut en
convenir, que la destruction et le massacre... 10
10. La Tribune, 16 juin 1833.
— Le second principe démocratique, toujours défendu par les républicains
lors de la conquête de l'Algérie, est celui du respect de la liberté religieuse. Il
faut dire que cette position est guidée non seulement par des principes fondamentaux
liés à la tradition des Droits de l'Homme, mais aussi par le rejet du
culte catholique qui forme déjà un des points forts de la propagande républicaine.
Celle-ci ne manque jamais une occasion — tout autant dans le débat
politique d'actualité que lorsqu'elle se livre à des analyses historiques — de condamner le pouvoir temporaire de l'Église romaine, assimilé totalement à la
tradition monarchiste d'Ancien Régime.
La France se doit d'être civilisatrice, pas missionnaire, tel est tout du moins
la conception des membres du parti républicain sous la monarchie de Juillet.
L'organisation d'un clergé en Afrique était assurément une œuvre impolitique en ce sens qu'elle éternisait la guerre avec les Arabes qui en feraient une guerre de religion, comme cela
s'est vu depuis ; elle était même impolitique vis-à-vis de la nation, parce qu'elle aurait pu voir dans cette organisation une tendance vers une classe d'hommes dont elle avait hautement
blâmé l'influence sous le règne précédent 11.
11. La Réforme, 17 octobre 1847
L'argumentation est parfois poussée plus loin et l'on nous propose même de faire de l'Islam un moyen de la colonisation :
L'islamisme peut servir aussi bien que le christianisme : car le Coran n'est pas moins libéral
que l'Évangile, et le fut-il moins, il aura quand on le voudra des interprètes qui le rendront tout
aussi souple. On a trouvé la Saint-Barthélémy dans l'Évangile sous Charles IX [...] Si les
Algériens sont fanatiques, il n'y a qu'un moyen, c'est d'avoir un grand nombre de marabouts
aux ordres du muphti, et d'intéresser celui-ci au développement de la civilisation. Elle se
répandra alors naturellement par les canaux de la religion 12
12. La Tribune, 19 juillet 1833.
Dans cet esprit, on oppose régulièrement la colonisation des États-Unis par
les Européens, qui ont exterminé les Indiens, à celle de l'Algérie par la France.
On rejette fermement toute politique de soumission excessive des populations
des territoires conquis aux modes de vie des Occidentaux. On raille les
colons voulant faire habiter des musulmans dans des immeubles construits sur
le modèle de l'architecture parisienne 13. On plaide pour le respect de la propriété des tribus :
Le système à suivre en ce qui concerne la propriété des tribus, c'est de la défendre contre
l'envahissement de la colonisation ; c'est de la laisser aux règles qui la régissent ; c'est d'agir
sur elles avec le seul moyen de l'impôt [...] le domaine de l'État est assez considérable pour
fournir à l'installation des colonies européennes. Il serait aussi inutile qu'injuste de spolier les tribus 14
13. La Tribune, 3 septembre 1833.
14. La Réforme, 29 octobre 1844.
... Enfin, en un mot comme en cent, on prône un système de colonisation
qui doit aboutir à l'assimilation progressive des musulmans par la seule vertu de
l'exemple des « bienfaits de la civilisation et du progrès » :
Ajoutons que les indigènes en profitent aussi ; tellement que jamais ils n'ont détruit ni une
route, ni un pont [...] Large part d'avantages aux vaincus, voilà ce qui légitime notre
conquête. Il nous reste à dire combien il sera facile de la consolider en l'honorant, et de quelle
horrible condition nous pouvons tirer ces peuples 15.
15. La Réforme, 31 mai 1844.
Tout ceci nécessite bien sûr le rejet d'une politique de refoulement, de
substitution des peuples conquis par les peuples conquérants. C'est Godefroy
Cavaignac — pour autant qu'il soit bien l'auteur des articles de la Réforme
signés G. C. — qui résume le mieux les positions de la gauche républicaine à ce sujet :
L'on nous dit : il vaudrait mieux que les populations nous laissassent le champ libre ; le grand
embarras c'est qu'elles ne nous fuient pas, comment les forcer à émigrer au désert ? Nous
répondrions : ce serait en effet une énorme injustice ; ce serait une faute et elle ressort de
maintes raisons. D'abord il y a largement la place pour vous auprès des tribus ; pourquoi
craindriez-vous leur voisinage ? Au contraire en les laissant auprès de vous, vous agirez sur
elles, vous les civiliserez, vous les surveillerez de près. En les rejetant dans le désert, vous
refouleriez toutes les haines ensemble ; les tribus se trouveraient seules avec elles-mêmes et,
en cas de guerre elles reviendraient en masse, plus sauvages, plus comparses et plus ennemies
que jamais. Ne l'oubliez pas, extermination n'a voulu dire d'abord que ceci, repousser une
population hors de ses frontières ; on sait ce que ce mot veut dire maintenant, et, en effet, si on
voulait se débarrasser des tribus, il ne faudrait pas les chasser, il faudrait les massacrer. C'est
une vieille habitude européenne en fait de colonies, mais il convient à la laisser à l'histoire de
l'Ancien Régime, avec tout ce qui raconte les démences atroces du passé 16.
16. La Réforme, 4 juin 1844.
Tous ces textes nous montrent clairement à quel point colonisation et droits
de l'Homme ne sont, pour les républicains de cette période, en aucun cas des
termes antagonistes. Bien au contraire, ils se complètent totalement, l'un étant le
moyen et l'autre la fin.
Pour eux, la démocratie est la forme politique naturelle d'un État « civilisé ». Si la France est encore dotée d'un régime censitaire, d'une « aristocratie
de l'argent » pour reprendre le terme habituel de la propagande républicaine,
c'est par une sorte d'anachronisme liée à l'histoire chaotique de la France depuis
la Révolution ; la forme politique a pris du retard par rapport au stade de
développement de la Nation. Coloniser c'est donner aux « États arriérés » les
moyens d'assurer leur développement sans lequel il n'est pas concevable qu'ils
aient accès à la démocratie.
La colonisation, dans les formes que nous venons de décrire, est donc bien,
pour les militants républicains de la monarchie de Juillet, une œuvre morale et politique, et c'est d'abord dans cette perspective — dans ce domaine comme
dans tout autre — qu'ils se situent.
Mais, à côté de cet argument fondamental, la nécessité de faire de la colonisation
une œuvre civilisatrice, il en est un autre dont se servent les républicains
pour prôner un certain respect des populations conquises : il s'agit tout simplement
de l'intérêt de la nation à voir s'installer une paix durable. Maltraiter les
musulmans, c'est s'exposer à leur désir de vengeance, c'est entrer dans la
spirale de la violence et de la guerre, contradictoire à une véritable colonisation.
Cette idée est présente dans de très nombreux articles et ce pendant toute la
période qui nous intéresse : « Grande leçon et qui prouve de plus en plus que
ce qui est odieux en morale est aussi stupide en politique », comment la Tribune dans son numéro du 16 juin 1833.
II. — LE RANG DE LA FRANCE
Après le devoir vient l'intérêt.
Si la France doit coloniser, c'est aussi afin d'accroître sa puissance dans le
concert des nations : « Si l'on considère l'intérêt spécial de la France, il n'est
pas douteux; il n'y a jamais de danger à s'enrichir, à étendre ses relations
commerciales, industrielles et politiques » 17. Cet intérêt national, les républicains
veulent en être les défenseurs infatigables. Pour cela ils militent pour la
création d'un « empire français », donnant à ce terme un sens d'impérialisme
colonial et non pas institutionnel, le souvenir des combats anti-bonapartistes est
trop présent dans leurs mémoires : « C'est une série de combats et de victoires
qui viennent ajouter un nouvel éclat à nos armes et déconcerter les haines et les
jalousies, en dépit desquelles nous saurons fonder un empire au-delà de la
Méditerranée » 18.
17. La Tribune, 20 juin 1833.
18. La Réforme, 28 octobre 1845.
Dans ce but, ils multiplient les prises de position allant toutes dans le sens
du renforcement des positions françaises dans le monde, quel qu'en soit le prix.
En fait, pour eux, ces deux questions : la mission civilisatrice de la France
et l'accroissement de sa puissance, n'en forment qu'une seule. C'est parce que
la France a un rôle spécifique à jouer, c'est parce qu'elle incarne un certain
nombre de valeurs positives, qu'il faut agir pour le renforcement de ses positions
dans le monde. La puissance de la France, c'est la puissance des Lumières, tel est tout au moins la conviction des militants républicains de la monarchie de Juillet.
Pour eux, l'Histoire a donné à chaque nation une mission à remplir. Les
« pays civilisés » doivent sortir les « peuples barbares » de leur situation.
Mais entre les « pays civilisés », tout se joue, dans le domaine de la conquête
de l'Algérie comme pour toute autre question de politique extérieure, dans la rivalité entre la France et l'Angleterre.
L'anglophobie est une constante de la propagande républicaine, une des
formes les plus bellicistes de son nationalisme. Pour elle, la lutte de ces deux
nations est un résumé des grands principes qui s'opposent dans le monde :
« l'égalité » et le « profit », « l'intérêt commun » et « l'intérêt particulier »,
le libéralisme et la fraternité. L'idée de nations devant s'affronter dans une lutte
impitoyable au nom de valeurs qu'elles sont censées incarner, est déjà une des
caractéristiques de la pensée républicaine encore confinée dans l'opposition.
Albert Laponneraye, fondateur en 1837 de l'Intelligence, le premier journal
communiste à avoir connu une parution régulière jusqu'en 1841, publie en
1842-1843, alors qu'il est encore le plus proche collaborateur d'Etienne Cabet,
principale figure du communisme français d'avant 1848, une Histoire des
de la France et de l'Angleterre depuis le moyen-âge jusqu'à nos jours. Cet
ouvrage — qui connaîtra en 1845 une version résumée sous le titre de Précis
des rivalités et des luttes de la France et de l'Angleterre — est un véritable
manifeste de l'anglophobie des républicains sous la monarchie de Juillet 19
Il y a des peuples qui sont naturellement artistes comme les anciens Grecs, il y en a d'autres
qui naissent avec le génie des conquêtes, comme les Romains, d'autres enfin qui se
passionnent pour toutes les idées grandes et généreuses comme les Français. Les Anglais eux
sont naturellement industriels et marchands 20.
9 . Sur Albert Laponneraye, cf. la thèse que nous avons soutenue sous la direction de M. le
professeur Philippe Vigier, en 1988 à l'université de Paris X.
20. Précis historique..., p. 5.
La grandeur de la France, c'est la référence à la Révolution de 1789-1793,
celle de l'Angleterre c'est la révolution industrielle. L'une incarne la générosité,
l'autre l'égoïsme, il est donc du devoir de tout démocrate de dénoncer « toutes
les perfidies, tous les crimes de cette nation sans pudeur et sans foi, qui n'est
riche que des dépouilles d' autrui, qui n'est grande que du malheur de tous » 21.
21. Idem, p. 1.
De telles positions seront partagées par l'ensemble du parti démocratique
dont l'anglophobie prendra toutes les formes : des plus violentes quand la
Réforme exigera que la France déclare la guerre à l'Angleterre suite à l'affaire de
Tahiti 22 aux plus saugrenues lorsque la feuille républicaine s'indignera que le
comte de Paris fasse distribuer des manuels de grammaire anglaise dans les écoles de la capitale 23. Le nationalisme, même sous sa forme la plus belliciste,
la plus dominatrice, celle qui considère que la France doit soumettre les autres
nations — et notamment la plus puissante d'entre elles — à son autorité, est
bien présent dans la pensée républicaine de la monarchie de Juillet.
En période de crise, en particulier dans les années 1844-1845 avec les
affaires de Tahiti et du Maroc, il s'exacerbe au point d'atteindre une violence qui
surprend toujours l'observateur contemporain. Il n'en est pas moins, notamment
à travers l'expression du sentiment anglophobe, une constante de la
pensée démocratique de cette période.
Le foyer des passions nationales est-il éteint pour jamais au cœur des hommes qui s'ingèrent
de conduire nos destinées ? Sont-ils devenus tout à fait incapables de comprendre la grandeur
de ces généreuses et puissantes haines qu'il fut donné à nos pères de puiser dans l'amour même
de l'humanité [. . .] Il faut vouloir la France grande, la France forte ; car la France forte et grande
se sera tôt ou tard l'univers affranchi 24.
22. La Réforme, 3 août 1844.
23. La Réforme, 12 novembre 1844.
24. « La nationalité française et l'Angleterre », La Réforme, 29 décembre 1844. C'est nous qui
soulignons
Cette question des rapports entre la France et l'Angleterre est d'ailleurs un
sujet constant de conflit entre les républicains et le gouvernement.
Quand Guizot refuse le conflit avec l'Angleterre et prône la politique de « la
paix à tout prix », la Réforme titre sur le « ministère des peureux », et la
stratégie d'alliance des ministères de Louis-Philippe est systématiquement
condamnée par l'organe de la propagande républicaine qui précise : « sur tous
les points du globe, mais nul part nous ne la payons aussi cher qu'en
Algérie » 25.
En effet c'est presque toujours sous cet éclairage, celui des rapports entre la
France et l'Angleterre, qu'est présentée la question de la conquête et de la colonisation
de l'Algérie.
Dès 1833, la Tribune dénonce un accord secret qui lierait la France et
l'Angleterre pour l'évacuation de l'Algérie 26.
Parce que la conquête de l'Algérie accroît la puissance française, elle est
insupportable au pouvoir britannique. Celui-ci exige donc des gouvernements
anglophiles de Louis-Philippe qu'ils évacuent cette colonie. Ces derniers
s'exécuteraient volontiers s'il n'y avait pas un profond sentiment national dans
l'opinion publique qui interdit à un tel processus d'aller à son terme... Tel est
du moins la thèse du parti républicain.
La cession d'Alger est le projet fixe du système; c'est quoi que l'on puisse dire la condition
sine qua non d'une alliance anglaise, et sans l'appréhension d'un soulèvement général de la
nation, il y a longtemps que cette conquête n'embarrasserait plus l'ordre des choses [...] La France conservera, en dépit de ses oppresseurs et de ses envieux une conquête si chèrement
acquise, elle accomplira sa glorieuse mission en introduisant sur cette terre de barbarie et
d'esclavage, la civilisation, les lumières, l'industrie et la liberté 27.
25. La Réforme, 3 décembre 1845.
26. La Tribune, 20 juin 1833.
27 . Le Journal du Peuple, 8 décembre 1839.
Même ton dans la presse communiste et notamment dans le Populaire
d'Etienne Cabet :
Et s'il était vrai, comme l'opposition l'a si souvent dit, que l'abandon d'Alger eût été résolu
dès 1830, et secrètement promis à l'Angleterre [...] S'il était vrai que quelques-uns de nos
gouvernants fussent impatients de voir les bastilles achevées 28 pour être plus maîtres d'abandonner
Alger, en bravant les criailleries des brouillons et des factieux, pour plaire à l'aristocratie
britannique 29.
28. Le gouvernement avait alors entrepris de ceindre Paris de fortifications. L'opposition républicaine
qui voyait là une précaution prise dans le but de réprimer d'éventuels mouvements populaires
avait engagé une lutte acharnée contre ce qu'elle appelait « l'embastillement de Paris ».
29. Le Populaire, 2 avril 1842.
Un gouvernement mou qui capitule constamment devant la puissance
britannique, quand il ne s'en fait pas directement l'agent, tel est l'image que
véhicule la propagande républicaine en faisant appel au sentiment d'honneur
national, contre l'aspiration à la paix et les politiques d'alliance. « Le sang de
nos soldats a-t-il acquis à leur patrie une des principales métropoles du commerce
africain, et tant de ports importants, pour en faire des débouchés à
l'industrie anglaise ? » 30.
Si nous trouvons de tels discours pendant toute l'époque qui nous intéresse,
il existe pourtant une période où l'anglophobie républicaine est portée à son
paroxysme : l'année 1844. C'est à ce moment qu'éclate l'affaire de Tahiti, et
surtout la guerre avec le Maroc.
Lorsque, le 13 juin, la Réforme annonce en « une » le début des hostilités,
c'est d'abord l'Angleterre qu'elle accuse, et non pas Abd el-Kader qui avait
pourtant entraîné le sultan du Maroc chez qui il avait trouvé refuge, dans cette
aventure.
30 . Le Journal du Peuple, 29 avril 1838.
Tout au long du conflit, dont le journal fait un état quasi quotidien, on
accuse les Britanniques de livrer secrètement des armes aux Marocains, de
mener une politique diplomatique active visant à isoler la France... D'être une
sorte de chef d'orchestre clandestin d'une guerre qu'ils auraient déclenchée dans
un seul but : réduire la puissance française en Afrique et l'obliger à quitter
l'Algérie sous les coups de boutoir d'Abd el-Kader. Bien entendu, le
gouvernement, parce qu'il est anglophile et libéral, est suspecté de manque
d'énergie dans ce conflit, voire même d'intelligence avec l'ennemi. Ceci sera
particulièrement vrai lorsque l'Angleterre tentera de se poser comme intermédiaire entre les belligérants.
La victoire de l'armée française, résultat de la bataille d'Isly remportée le
14 août par le général Bugeaud et des bombardements de Tanger et de
Mogador, ne change en rien les convictions des républicains. Tanger et
Mogador ont été bombardées, elles auraient dû être occupées. Quant à la bataille
d'Isly, « c'est un glorieux fait d'armes; mais il serait trop étrange de voir le
ministère en revendiquer le mérite » 31.
Mais ce sont surtout les conditions de la paix qui mettront les démocrates
hors d'eux. Quand le Constitutionnel publie le texte du traité, la Réforme, dans
son numéro du 26 septembre 1844, ne trouve pas de mots assez durs pour
condamner ce texte, derrière lequel elle voit bien entendu la main de l'Angleterre.
Accusant le Gouvernement d'avoir mis « Abd el-Rhaman en position de
victorieux », les républicains s'indignent notamment que le Maroc ne doive pas
payer d'indemnités à la France. Mais c'est surtout le fait qu'Abd el-Kader — dont la Réforme du 31 août disait : « nous devons exiger qu'il nous soit
livré comme citoyen français » — ait réussi à s'échapper qui motive les réactions de l'opposition.
31. La Réforme, 22 septembre 1844.
III. — L'ALGÉRIE ET LA FRANCE
Si la continuité est une vertu en politique, l'opposition républicaine sous la
monarchie de Juillet peut seule en revendiquer le mérite, tout au moins en ce qui
concerne l'Algérie.
En effet, le moins que l'on puisse dire, c'est que sur cette question la politique
gouvernementale fut essentiellement marquée par ses tergiversations et ses
retournements.
Hésitations quant à la conservation des positions conquises entre 1830 et
1834 ; politique « d'occupation restreinte » du seul littoral, avec soutien à Abd
el-Kader alors en guerre contre les Turcs ; politique de conquête et « système
guerroyant » de Clauzel qui échoue en novembre 1836 ; traité de la Tafna, signé
par Bugeaud le 30 mai 1837 abandonnant les deux-tiers de l'Algérie à Abd el-
Kader ; reprise en novembre 1839 des hostilités... Tout démontre que le pouvoir
ne savait pas trop quelle attitude prendre vis-à-vis de la conquête et que, dans ce
domaine, l'empirisme a joué un rôle plus important que la détermination 32.
Tous ces atermoiements étaient facilement explicables dans la logique de
parti républicain : il ne s'agit que de préparer l'évacuation du territoire algérien pour plaire à l'allié anglais. La crédibilité des républicains était considérablement
renforcée par le fait qu'ils avaient toujours défendu une même orientation qui
peut se résumer en deux points : colonisation complète et civile de l'Algérie tout
d'abord, pacification et intégration de l'Algérie à la France ensuite.
32. Sur la politique française, on se référera aux travaux de Ch.-A. Julien et Ch.-R. Ageron (cf.
note 1), mais aussi à la source indispensable que représentent les Mémoires de ma vie de Charles de RÉMUSAT.
Dès le 6 janvier 1831, la Tribune publie une correspondance demandant que
l'Algérie « nous ouvre tout l'intérieur d'un continent, qu'elle offre du travail et
un asile à un excédent de population... ».
— La colonisation doit être totale. Abandonner une partie des conquêtes,
c'est, pour les républicains, renoncer à civiliser ces territoires et perdre des
possessions faisant partie de la puissance nationale. Au nom de ce principe, des
campagnes d'opinion sont menées aussi bien contre l'abandon défendu par
certains à la Chambre que contre l'occupation partielle ou les accords de Tafna
que le Journal du Peuple appelle « la paix Bugeaud » et sur lesquels il
s'exprime en ces termes : « Sans doute une pacification est nécessaire, mais il
faut une paix honorable et non une paix à tout prix, non une cession de la
colonie à un bédouin qui n'eut jamais d'autorité légale, et que nos généraux
seuls ont grandi » 33.
— La colonisation doit être civile. Tout d'abord parce que la colonisation
militaire, c'est l'état de fait permanent et la multiplication des exactions propres
à susciter la révolte des populations conquises. Ensuite parce que l'instauration
d'un État de droit civil est une nécessité pour l'organisation de la vie sociale par
les colons dans le cadre national : « l'épée prépare la civilisation, elle ne saurait
l'accomplir » 34. Enfin, parce que les républicains ont une méfiance instinctive
pour les généraux dotés de pouvoirs trop étendus, surtout s'ils se sont illustrés,
comme Bugeaud, pendant les guerres napoléoniennes et les Cent Jours et
peuvent être soupçonnés de préparer « sourdement toute chose pour un
nouveau 18 Brumaire » 35.
— Intégration de l'Algérie à la France : « C'est l'Algérie française qu'il
s'agit d'organiser », proclame la Réforme dans son numéro du 17 décembre
1844. Telle est en effet la conclusion logique et quasi mécanique des positions
défendues par les républicains. Tout les pousse à demander l'incorporation de
l'Algérie à la France :
[...] assimilation politique de l'Algérie, sa naturalisation complète. Il faut, le plus possible,
que notre conquête soit organisée à l'instar de nos départemens, incorporée pleinement à la
famille et à l'institution nationale [. . .] Cela s'accorde d'ailleurs avec notre esprit d'unité ; cela garantit doublement l'avenir de nos possessions, car celles qu'on n'assimile point, tendent à se
séparer en se développant, c'est-à-dire quand leur conservation serait plus que jamais précieuse
et paierait la métropole de ses sacrifices... 36
33. Le Journal du Peuple, 18 juin 1837.
34. La Réforme, 17 décembre 1844. Dans ce sens, une des revendications des républicains, se
faisant ainsi l'écho de nombreux colons, est la substitution au régime des ordonnances et des arrêtés
qui sévissent alors en Algérie, par celui de la loi.
35. La Réforme, 2 décembre 1843.
36. La Réforme, 10 juin 1844
Assimiler l'Algérie à la France afin de créer un lien indissociable entre les
deux territoires, telle est la revendication des républicains. Elle leur permet
notamment de rejeter pour cette région le statut de colonie tel qu'il était appliqué
« outre-mer », c'est-à-dire un régime d'exception par rapport aux règles du
droit national. Pour ce faire, on met en avant le problème de l'esclavage dont
l'abolition est l'objet d'une campagne incessante du parti républicain : « Le
droit moderne, le droit français doit suivre partout au pied de l'Atlas la trace
victorieuse de notre drapeau » 37. En ce sens, en mars-avril 1845, les républicains
se font largement l'écho d'une pétition à la Chambre de colons d'Algérie
demandant « la réunion de l'Algérie à la France » : « Nous ne pouvons
qu'applaudir de toute notre âme à cette grande et patriotique manifestation [. . .]
Il est temps que l'opinion publique se décide énergiquement en faveur d'un
pays qui doit devenir une seconde France », explique la Réforme du 4 mars.
Cela correspond d'ailleurs tout à fait à l'idée que se font les républicains de
la « mission civilisatrice de la France ». Si la France est civilisée, c'est d'abord
parce que son histoire l'a constituée en nation, a réalisé l'unité de son sol et de
son droit. L'Algérie, pour eux, n'est pas une nation, ni même un pays, mais un
territoire sans unité sur lequel vivent des tribus rivales ne pouvant trouver que
dans le fanatisme religieux un élément de cohésion. Coloniser l'Algérie, c'est
lui permettre d'avoir accès à ce statut élevé de la civilisation humaine qu'est la
nation. En ce sens, le colonialisme est pour eux le prolongement de l'idée
progressiste de la nation contrat. Parce qu'une nation ne se réduit pas à la patrie,
« la terre des pères », elle peut, elle doit, au nom du progrès et de la raison,
s'étendre à de nouveaux territoires et à de nouveaux hommes restés à un niveau
inférieur de civilisation. Les républicains sont ainsi persuadés qu'ils font faire
un bon en avant de plusieurs siècles aux tribus algériennes en les intégrant
— même progressivement — à la nation française. Et si pour cela il faut
soumettre des peuples, aveuglés par « l'ignorance et le fanatisme », qui
refusent de s'engager dans la voie du progrès, cela fait partie de « l'inévitable
part du mal dans la production du bien » 38.
Tout cela signifie bien sûr que les républicains rejettent d'un revers de main l'idée d'une nation arabe :
cette prétendue nationalité arabe qu'on a voulu si ridiculement opposer à la nationalité française
n'a jamais existé. Abd-el-Kader, homme éminent l'avait conçue, sans doute ; mais c'était une entreprise plus récente et plus difficile que notre conquête elle-même. Tout a croulé le jour
où le gouvernement français n'a plus aidé lui-même l'émir à faire un corps de nation avec ces
débris de trente peuples que les haines incessantes divisaient 39.
37. La Réforme, 7 septembre 1844.
38. La Réforme, 17 mai 1844.
39. Idem.
Nous le voyons, dans leur esprit, toutes les conditions sont réunies pour
intégrer l'Algérie à la France. Mais pour cela il y a deux préalables : pacifier le
territoire et organiser une administration provisoire.
— Pacifier le territoire tout d'abord. Dans ce domaine, l'attitude des républicains
est simple : entente et tolérance avec les peuples qui acceptent la colonisation ; guerre à outrance, en profitant des divisions entre les tribus 40, dès que
la résistance s'organise. Ce bellicisme à rencontre de ceux qui se lèvent contre
la puissance française est le fait de toutes les composantes de la gauche républicaine,
qu'elles soient démocratiques, socialistes ou communistes. Peut-être
faut-il penser que ce caractère guerrier a été renforcé par l'état d'esprit des
jeunes dirigeants de ce mouvement. Souvent nés pendant les premières années
du siècle, ils ont été élevés dans le souvenir des grandeurs révolutionnaires et
impériales qu'ils n'ont pas connues. Ils souffrent de vivre dans une époque
qu'ils jugent bien fade, où l'intérêt et le profit occupent une place plus grande
que l'honneur et la gloire. Ils aspirent à une révolution nouvelle qui permettra à
l'histoire de s'emballer de nouveau en faisant d'eux des héros. De ce point de
vue, l'Algérie est une sorte de rêve. C'est l'endroit, sur une terre à la fois lointaine
et mystérieuse, où subsistent les dernières démonstrations d'une grandeur
oubliée et que l'on souhaite réveiller. C'est là que de jeunes soldats meurent
héroïquement, comme à Mazagran à « un contre cent » face à des « nuées de
cavaliers arabes » 41. Souvenons-nous des mots employés par Ledru-Rollin au
sujet d'Eugène Cavaignac lors de l'enterrement de son frère 42, et écoutons le
Prolétaire de Poitiers du 5 mars 1847.
Un seul point nous reste où le bruit de nos armes retentit encore. C'est l'Algérie ! c'est là
seulement où nous voyons briller de temps à autre ce courage à toute épreuve, ce caractère fier
et indomptable que les Français possèdent seul et sans partage. C'est là aussi qu'il faut aller
chercher ces quelques exemples de patriotisme qui s'éteignent chaque jour dans la mère patrie.
40. La presse républicaine prône en particulier une alliance privilégiée avec les Kabyles contre Abd el-Kader.
41 . Cf. notamment l'Intelligence de mars 1840, la Propagande de novembre 1839 et les articles du Journal du Peuple consacrés à Mazagran.
42. Cf. note 3.
— Organiser l'administration provisoire du territoire algérien ensuite.
A terme, la « civilisation » permettra à tous les habitants de l'Algérie,
indigènes comme colons, de vivre dans un régime d'égalité et de démocratie.
Mais d'ici là, dans la période transitoire nécessaire, quelle administration doit-
on donner à l'Algérie ? Voici une question à laquelle se devait de répondre le parti républicain en essayant de résoudre une contradiction de ses positions ;
comment assurer l'intégration de l'Algérie à la France tout en laissant suffisamment
d'autonomie aux tribus pour ne pas susciter leur révolte contre
l'occupant et préparer leur assimilation progressive ?
La solution proposée est simple : les autorités supérieures doivent être
mises dans des mains françaises, les autorités les plus proches des populations
peuvent être laissées à des indigènes.
Cela correspond bien à l'idée que se font les républicains des populations
conquises. S'il n'y a pas de nation algérienne mais seulement des tribus, il est
normal, dans leur esprit, que tout ce qui dépasse cette forme primitive d'organisation
sociale leur échappe.
Dans le même temps, les républicains demandent l'abolition de ce qu'ils
estiment être les formes les plus évidentes de la barbarie dans la société algérienne
: le système des castes et l'esclavage.
Écoutons Godefroy Cavaignac décrire ce système dans la Réforme du 7 juin 1844 :
Le premier pas de l'assimilation française, c'est l'abolition des castes oppressives [...] Voilà
pourquoi des indigènes peuvent préférer des chefs français aux leurs [. . .] D'ailleurs, il ne s'agit
pas d'enlever aux indigènes les fonctions qui correspondent à nos fonctions municipales. Il ne
faut pas, dans l'intérêt commun, que l'autorité française soit trop au contact avec le détail des
hommes et des choses dans les populations. Il serait bon, pour employer une comparaison qui
s'accorde avec le caractère militaire de l'administration, chez les arabes, que les sous-officiers et
les grades subalternes, que les chefs de fractions de tribu et même de chaque tribu fussent
[. . ] II conviendrait de maintenir aussi l'autorité judiciaire des cadis, en les surveillant de
près, car leur vénalité est proverbiale [...] Le pouvoir religieux des marabouts, il faudrait le
restreindre avec précaution. Mais les groupes, les grandes circonscriptions commandées
aujourd'hui par les aghas et les Khalifes, nous disons qu'il faut en confier la direction à des
mains françaises [...]
La présente étude permet, nous l'espérons, de mettre en évidence une forte
continuité dans les positions républicaines sur la colonisation de l'Algérie.
En nous concentrant sur une période très précise, nous avons essayé de
remonter aux origines de la pensée politique de ce parti.
En multipliant les citations, choix toujours discutable, nous espérons avoir
mis en relief des sources qui ont, tout du moins en ce qui concerne le problème
qui nous intéresse ici, été assez peu étudiées.
Nous avons en tout cas la conviction qu'elles nous permettent de bien
comprendre la signification du nationalisme républicain de ce premier
XIXe siècle. Parce qu'ils assimilent totalement les valeurs de la démocratie avec
la nation censée les incarner, les républicains de la monarchie de Juillet considère
que la nation française a le devoir de faire profiter l'universalité des hommes des acquis de sa civilisation. Elle se doit d'entrer en lutte afin d'assurer
la domination de ce qu'elle représente sur le monde.
Pour eux, il ne peut y avoir de « droit des peuples » sur des territoires où il
n'y a pas de droit parce qu'il n'y a pas de nation. Le nationalisme légitime donc
parfaitement leur colonialisme en assimilant totalement la diffusion du progrès et
de la démocratie et l'extension de la puissance nationale.
Ces positions, développées par des hommes que personne ne peut accuser
de cynisme, nous permettent de bien prendre la mesure de la force du sentiment
national chez les militants qui seront bientôt les acteurs du « printemps des
peuples » de 1848 43.
Mais ces textes nous permettent aussi de constater à quel point la démocratie
française a dû opérer une profonde rupture avec sa propre histoire pour
s'engager dans la voie de la décolonisation. Elle a alors su choisir entre les
principes démocratiques et ceux de l'intérêt national immédiat, en remettant en
cause certaines des bases de sa pensée politique. C'est sans doute cela aussi, tel
est du moins notre conviction, qui a fait sa force.
43. On relit avec intérêt la façon dont l'université d'Alger avait participé aux manifestations du
centenaire de la révolution de 1848 {cf. M. Emerit, La révolution de 1848 en Algérie
Philippe Darriulat , In: Revue française d'histoire d'outre-mer, tome 82, n°307, 2e trimestre 1995. pp. 129-147
https://www.persee.fr/doc/outre_0300-9513_1995_num_82_307_3312
|
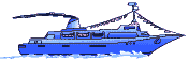 Retour au menu "Contexte"
Retour au menu "Contexte"